La décision de retirer le nom de Trump du bulletin de vote au Colorado forcera la Cour suprême des États-Unis à intervenir, ce qui pourrait entraîner de nombreuses conséquences et désaccords dans la politique américaine.
La Cour suprême du Colorado a décidé le 19 décembre de retirer l'ancien président Donald Trump du scrutin primaire de l'État, affirmant qu'il était impliqué dans les émeutes du Capitole et qu'il n'était donc pas éligible à la présidence en vertu de l'article 3 du 14e amendement de la Constitution américaine.
Le 14e amendement a été adopté après cinq ans de guerre de Sécession (1861-1865), afin d'empêcher ceux qui avaient juré allégeance à la Constitution mais s'étaient « engagés dans une rébellion ou une insurrection » contre le pays de se représenter aux élections. « Le président Trump a incité et encouragé le recours à la force et à des comportements illégaux pour entraver le transfert pacifique du pouvoir », a expliqué la Cour du Colorado dans son jugement.
Cependant, les observateurs estiment que cette décision pourrait perturber les élections primaires dans de nombreux États où M. Trump est poursuivi pour avoir prétendument « annulé » l'élection de 2020, ainsi que l'élection nationale qui aura lieu en novembre 2024.
Le porte-parole de M. Trump a dénoncé la décision du Colorado comme étant « totalement erronée » et a annoncé qu'il ferait appel devant la Cour suprême fédérale, demandant une réinterprétation du 14e amendement. Dans ce contexte, les neuf juges de la Cour suprême devront rendre, pour la deuxième fois en plus de deux décennies, une décision susceptible de déterminer l'issue de l'élection présidentielle.

L'ancien président américain Donald Trump lors d'une audience à New York le 6 novembre. Photo : AFP
La dernière fois qu’une décision de la Cour suprême a eu un impact direct sur une élection américaine, c’était en 2000, lorsque le républicain George W. Bush et le vice-président démocrate Al Gore ont contesté le 14e amendement, et que les républicains ont cherché à protéger leurs candidats sur la voie de la Maison Blanche.
Lors de l'élection présidentielle de 2000, la Floride est devenue l'État décisif entre Al Gore et George W. Bush. Initialement, M. Gore était pressenti pour remporter la Floride, mais il a appelé Bush pour le féliciter lorsqu'il a constaté que son adversaire menait de plusieurs dizaines de milliers de voix à mi-dépouillement. Moins d'une heure plus tard, Gore est revenu sur sa décision lorsque les résultats actualisés ont montré que l'écart entre les deux s'était considérablement réduit.
Le décompte des voix étant si serré, la Floride a recompté les votes des deux candidats selon la procédure en vigueur. La controverse a éclaté lorsque la commission électorale a découvert de nombreux bulletins erronés et un risque de dysfonctionnement des machines, ce qui a poussé la Cour suprême de Floride à ordonner un décompte manuel de tous les bulletins, ce qui pourrait retarder de plusieurs jours les résultats définitifs.
Les républicains ont porté l'affaire devant la Cour suprême fédérale, sollicitant une interprétation du principe d'« égalité de protection » inscrit dans le 14e amendement. Ils ont fait valoir que la norme appliquée par la Cour suprême de Floride à son seul État était injuste envers les autres États et devait invalider la décision de recomptage.
Plus d'un mois après l'élection, avec cinq juges pour et quatre contre, la Cour suprême des États-Unis a statué en faveur du candidat Bush, empêchant la Floride de procéder à un recomptage manuel des votes. Al Gore, ne voulant pas prolonger le chaos politique américain, a renoncé à faire appel et a déclaré sa défaite en Floride. M. Bush a gagné avec plus de grands électeurs, bien qu'il ait perdu environ six millions de voix populaires face à Gore.
L'affaire Bush contre Gore a porté atteinte à la crédibilité de la Cour suprême, car les décisions des juges affectent directement les résultats des élections présidentielles. Ses opposants soutiennent que les recomptages relèvent des agences électorales des États et que, par conséquent, la Cour suprême a commis une erreur en s'immisçant dans les décisions des États.
Plus de 20 ans plus tard, la Cour suprême des États-Unis est à nouveau confrontée à la nécessité d'intervenir dans le processus électoral. Les observateurs craignent que la réputation de la Cour ne continue d'être mise à mal, la société américaine étant profondément polarisée entre deux courants d'opinion publique, l'un favorable à M. Trump, l'autre défavorable.

L'ancien président américain Donald Trump s'adresse à ses partisans à Conroe, au Texas, en janvier 2022. Photo : Reuters
La décision du Colorado, bien que valable uniquement pour l'élection primaire visant à choisir le candidat républicain, pourrait également s'appliquer à l'élection officielle de la fin de l'année prochaine, au cas où M. Trump deviendrait l'adversaire du président Biden.
Cette décision pourrait également servir de base à un tribunal de l'État de Géorgie et à un tribunal fédéral de Washington pour juger Trump pour fraude électorale. L'ancien président américain a plaidé non coupable et les tribunaux de l'État et fédéral n'ont pas encore rendu de décision définitive.
L'équipe juridique de Trump tente de faire appel devant la Cour suprême et tente également d'annuler la décision du tribunal du Colorado pour éviter qu'elle ne devienne un précédent dans d'autres États dans des poursuites contre lui pour « incitation » à annuler l'élection de 2020.
Toutefois, certains experts estiment que la Cour suprême des États-Unis dispose cette fois-ci d'une base juridique plus solide pour intervenir dans la décision du Colorado que dans le litige électoral de 2000.
Dans l'affaire de 2000, la Cour suprême a dû déterminer si elle avait le pouvoir d'intervenir dans la décision de la Floride concernant le décompte des voix. Cette fois, la Cour du Colorado a appliqué le 14e amendement de la Constitution américaine pour disqualifier M. Trump. La Cour suprême a donc toute autorité pour statuer et intervenir, a déclaré Luke Sobota, greffier de l'ancien président de la Cour suprême William Rehnquist, qui a arbitré le litige entre Al Gore et George W. Bush.
« Dans le contexte où M. Trump est confronté à de nombreux cas similaires dans d'autres États, la Cour suprême doit clarifier si la clause anti-insurrectionnelle citée par le tribunal du Colorado est appropriée ou non, pour éviter que chaque État n'interprète cette disposition de manière différente », a déclaré Sobota, désormais avocat clé au sein du cabinet d'avocats international américain Three Crowns.
Alexander Reinert, professeur de droit à l'Université Yeshiva de New York, a déclaré que si la Cour suprême se saisit de l'affaire, toute décision qu'elle rendra aurait de profondes implications pour la politique américaine.
Si les juges statuent en faveur de Trump, la crédibilité de la plus puissante cour des États-Unis pourrait être remise en question. La Cour suprême est majoritairement conservatrice, et compte notamment trois juges nommés par Trump.
Mais s'ils se prononcent contre Trump, ils risquent de s'exposer à une vague de colère de la part de millions de ses partisans. Trump a récemment cherché à attiser cette colère, qualifiant la décision du tribunal du Colorado de « chasse aux sorcières » et de « complot d'ingérence électorale ».
Ted Olson, avocat ayant représenté M. Bush devant la Cour suprême en 2000, a déclaré que les juges devraient rapidement accepter l'appel de M. Trump. Il a soutenu que l'annulation de la décision du Colorado était nécessaire pour que la politique américaine garantisse des élections équitables, puisque seuls les électeurs ont le droit de décider qui est digne de voter.
« La décision du Colorado empêche non seulement les électeurs de voter pour Trump, mais aussi ceux qui votent contre l'ancien président », a déclaré Olson.
Thanh Danh (selon WSJ, Politico )
Lien source








































































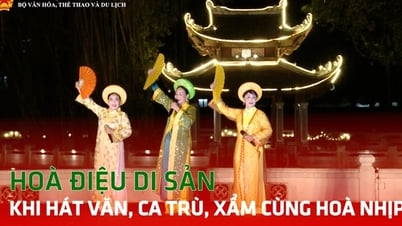



























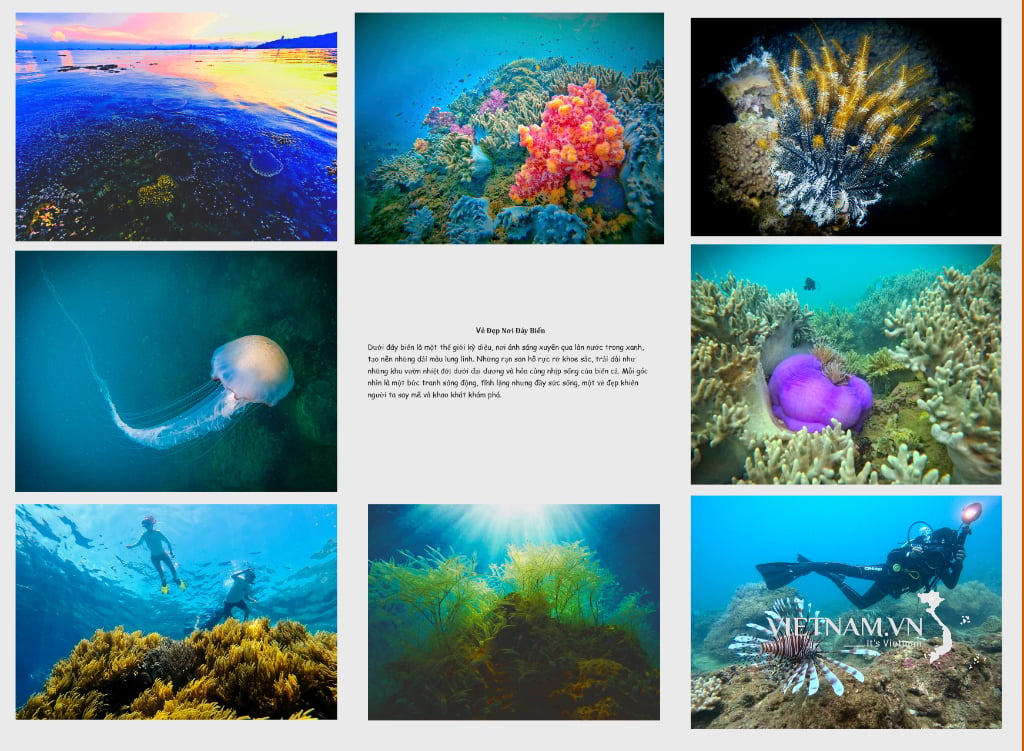
Comment (0)