 |
| Le Premier ministre chinois Zhou Enlai et son camarade Le Duc Tho à Pékin. |
De la Conférence de Genève
Le 8 mai 1954, jour après la victoire éclatante de Dien Bien Phu, la Conférence sur l'Indochine s'ouvrit à Genève avec la participation de neuf délégations : l'Union soviétique, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et la Chine, la République démocratique du Vietnam, l'État du Vietnam, le Royaume du Laos et le Royaume du Cambodge. Le Vietnam demanda à plusieurs reprises d'inviter des représentants des forces de résistance laotiennes et cambodgiennes à assister à la Conférence, mais sa demande fut rejetée.
Concernant le contexte et les intentions des parties participant à la Conférence, il convient de souligner que la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis avait atteint son apogée. Parallèlement à la guerre froide, la guerre chaude s'est déroulée dans la péninsule coréenne et en Indochine ; une tendance à la détente internationale s'est manifestée. Le 27 juillet 1953, la guerre de Corée a pris fin et la Corée a été divisée au 38e parallèle, comme auparavant.
En Union soviétique, après la mort de Staline (mars 1953), la nouvelle direction, dirigée par Khrouchtchev, a ajusté sa stratégie de politique étrangère : promouvoir la détente internationale pour se concentrer sur les problèmes intérieurs. Concernant la Chine, qui a subi des pertes après la guerre de Corée, ce pays a élaboré son premier plan quinquennal de développement socio -économique, souhaitant mettre fin à la guerre d'Indochine. Il avait besoin de sécurité dans le Sud, a levé le siège et l'embargo imposés par les États-Unis, a éloigné les États-Unis du continent asiatique et a promu son rôle de grande puissance dans la résolution des problèmes internationaux, en premier lieu asiatiques.
Après huit années de guerre, la France, qui avait subi de lourdes pertes humaines et financières, souhaitait s'en sortir avec honneur tout en préservant ses intérêts en Indochine. De son côté, à l'intérieur du pays, les forces hostiles à la guerre, exigeant des négociations avec le gouvernement de Hô Chi Minh, accentuaient la pression. La Grande-Bretagne ne souhaitait pas que la guerre d'Indochine s'étende, compromettant ainsi la consolidation du Commonwealth en Asie et soutenant la France.
Seuls les États-Unis, refusant les négociations, tentèrent d'aider la France à intensifier la guerre et à intensifier son intervention. De leur côté, les États-Unis souhaitaient inciter la France à rejoindre le système de défense de l'Europe occidentale contre l'Union soviétique, et soutinrent donc la participation de la France et de la Grande-Bretagne à la Conférence.
Dans ce contexte, l'Union soviétique proposa une conférence quadrilatérale réunissant les ministres des Affaires étrangères de l'Union soviétique, des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France à Berlin (du 25 janvier au 18 février 1954) pour discuter de la question allemande. Cependant, cette conférence échoua et elle se tourna vers les questions coréenne et indochinoise. Compte tenu de ces questions, la conférence invita à l'unanimité la Chine à y participer, comme l'avait proposé l'Union soviétique.
En ce qui concerne le Vietnam, le 26 novembre 1953, en réponse au journaliste Svante Lofgren du journal Expressen (Suède), le président Ho Chi Minh a exprimé sa volonté de participer aux négociations sur un cessez-le-feu.
Après 75 jours de négociations ardues, comprenant huit assemblées générales et 23 réunions restreintes, ainsi que d'intenses contacts diplomatiques, l'accord fut signé le 21 juillet 1954. Il comprenait trois accords de cessez-le-feu au Vietnam, au Laos et au Cambodge, ainsi que la déclaration finale de la conférence en 13 points. La délégation américaine refusa de signer.
Le contenu principal de l'Accord est que les pays participant à la Conférence déclarent respecter l'indépendance, la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge ; cesser les hostilités, interdire l'importation d'armes, de personnel militaire et l'établissement de bases militaires étrangères ; organiser des élections générales libres ; retirer les troupes françaises et mettre fin au régime colonial ; le 17e parallèle est la ligne de démarcation militaire temporaire au Vietnam ; les forces de résistance laotiennes ont deux zones de rassemblement dans le nord du Laos ; les forces de résistance cambodgiennes sont démobilisées sur place ; la Commission internationale de surveillance et de contrôle comprend l'Inde, la Pologne, le Canada, etc.
Comparés à l'Accord préliminaire du 6 mars et à l'Accord provisoire du 14 septembre 1946, les accords de Genève constituèrent un grand pas en avant et une victoire importante. La France dut reconnaître son indépendance, sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale et retirer ses troupes du Vietnam. La moitié de notre pays fut libérée, devenant ainsi une importante base arrière pour la lutte pour la libération complète et l'unification nationale.
Cet accord revêt une importance capitale, mais comporte également certaines limites. Il offre de précieux enseignements à la diplomatie vietnamienne, notamment en matière d'indépendance, d'autonomie et de solidarité internationale ; de combinaison des forces militaires, politiques et diplomatiques ; de recherche stratégique… et surtout d'autonomie stratégique.
Dans une interview accordée au journal Expressen le 26 novembre 1953, le président Ho Chi Minh affirmait : « … Les négociations de cessez-le-feu sont principalement une affaire entre le gouvernement de la République démocratique du Vietnam (RDV) et le gouvernement français. » Cependant, le Vietnam participait aux négociations multilatérales et n'était que l'une des neuf parties, ce qui rendait difficile la protection de ses propres intérêts. Comme le remarquait le lieutenant-général et professeur Hoang Minh Thao : « Malheureusement, nous négociions dans un forum multilatéral dominé par de grandes puissances, et l'Union soviétique et la Chine avaient également des calculs que nous ne comprenions pas pleinement, de sorte que la victoire du Vietnam n'a pas été pleinement exploitée. »
 |
| Le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique Brejnev a reçu et s'est entretenu avec le camarade Le Duc Tho après avoir paraphé l'Accord de Paris sur le chemin du retour chez lui, en janvier 1973. |
À la Conférence de Paris sur le Vietnam
Au début des années 1960, la situation internationale connut d'importants développements. L'Union soviétique et les pays socialistes d'Europe de l'Est continuèrent de se consolider et de se développer, mais le conflit sino-soviétique s'intensifia et la division au sein des mouvements communiste et ouvrier internationaux s'accentua.
Le mouvement d'indépendance nationale a continué de croître fortement en Asie et en Afrique. Après la défaite de la Baie des Cochons (1961), les États-Unis ont abandonné la stratégie des « représailles massives » et ont proposé une stratégie de « riposte graduée » visant le mouvement de libération nationale.
En appliquant la stratégie de « réponse flexible » au Sud-Vietnam, les États-Unis ont mené une « guerre spéciale » pour construire une armée de Saïgon forte avec des conseillers, du matériel et des armes américains.
La « guerre spéciale » menaçant d'échouer, les États-Unis envoyèrent des troupes à Da Nang et Chu Lai, début 1965, déclenchant une « guerre locale » au Sud-Vietnam. Parallèlement, le 5 août 1964, les États-Unis lancèrent une guerre de destruction au Nord. Les 11e et 12e Conférences centrales (mars 1965) et 12e (décembre 1965) affirmèrent la détermination et l'orientation de la guerre de résistance contre les États-Unis pour sauver le pays.
Après la victoire de la contre-offensive menée lors des deux saisons sèches de 1965-1966 et 1966-1967 contre la guerre de destruction au Nord, notre Parti a décidé d'adopter la stratégie du « combat tout en négociant ». Début 1968, nous avons lancé une offensive générale et un soulèvement qui, bien qu'échoué, a porté un coup fatal, ébranlant la volonté d'invasion des impérialistes américains.
Le 31 mars 1968, le président Johnson fut contraint de décider de cesser les bombardements du Nord-Vietnam et se prépara à envoyer des représentants au dialogue avec la République démocratique du Vietnam, ouvrant ainsi les négociations de Paris (du 13 mai 1968 au 27 janvier 1973). Ce furent des négociations diplomatiques extrêmement difficiles, les plus longues de l'histoire de la diplomatie vietnamienne.
La conférence s'est déroulée en deux phases. La première, du 13 mai au 31 octobre 1968, concernait les négociations entre la République démocratique du Vietnam et les États-Unis sur la cessation totale des bombardements américains sur le Nord-Vietnam.
Deuxième phase, du 25 janvier 1969 au 27 janvier 1973 : Conférence quadripartite pour la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam. Outre les délégations de la RDV et des États-Unis, la conférence a accueilli le Front de libération nationale du Sud-Vietnam (FLN)/Gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam (GRP) et le gouvernement de Saïgon.
À partir de la mi-juillet 1972, le Vietnam s'est engagé de manière proactive dans des négociations de fond pour signer l'accord après avoir remporté la campagne du printemps-été 1972 et l'approche de l'élection présidentielle américaine.
Le 27 janvier 1973, les parties signèrent un document appelé Accord sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam, composé de 9 chapitres et 23 articles, ainsi que de 4 protocoles et 8 accords, répondant aux quatre exigences du Politburo, notamment le retrait des troupes américaines et le maintien de nos troupes.
Les négociations de Paris ont laissé de nombreuses leçons importantes à la diplomatie vietnamienne : l’indépendance, l’autonomie et la solidarité internationale ; la combinaison de la force nationale et contemporaine ; la diplomatie comme front ; l’art de la négociation ; la lutte de l’opinion publique ; la recherche stratégique, en particulier l’indépendance et l’autonomie.
Tirant les leçons de la Conférence de Genève de 1954, le Vietnam a planifié et mis en œuvre de manière indépendante sa propre politique de résistance antiaméricaine, ainsi que sa politique étrangère et sa stratégie diplomatique d'indépendance et d'autonomie, mais toujours en coordination avec les pays frères. Le Vietnam a négocié directement avec les États-Unis… Ce fut la raison fondamentale de la victoire diplomatique dans la guerre de résistance antiaméricaine pour sauver le pays. Ces leçons sont toujours d'actualité.
 |
| La couverture du New York Daily News du 28 janvier 1973 disait : La paix est signée, la conscription est terminée : la guerre du Vietnam prend fin. |
Autonomie stratégique
La leçon d’indépendance et d’autonomie tirée des négociations de Paris (1968-1973) est-elle liée à la question de l’autonomie stratégique dont débattent actuellement les chercheurs internationaux ?
Selon le dictionnaire Oxford, la « stratégie » désigne l'identification d'objectifs ou d'intérêts à long terme et les moyens d'y parvenir ; tandis que l'« autonomie » reflète la capacité à s'autogouverner, à être indépendant et à ne pas être influencé par des facteurs externes. L'« autonomie stratégique » désigne l'indépendance et l'autonomie d'un sujet dans la détermination et la mise en œuvre de ses objectifs et intérêts importants à long terme. De nombreux chercheurs ont généralisé et donné différentes définitions de l'autonomie stratégique.
En fait, l'idée d'autonomie stratégique a été affirmée par Ho Chi Minh il y a longtemps : « L'indépendance signifie que nous contrôlons toutes nos activités, sans ingérence extérieure. » Dans l'Appel pour la fête de l'Indépendance du 2 septembre 1948, il a développé ce concept : « L'indépendance sans armée, diplomatie et économie propres. Le peuple vietnamien n'aspire absolument pas à cette unité et à cette indépendance factices. »
Ainsi, non seulement la nation vietnamienne est indépendante, autonome, unifiée et territorialement intacte, mais sa diplomatie et ses affaires étrangères doivent également être indépendantes et ne pas être contrôlées par une quelconque puissance ou force. Concernant les relations entre les partis communistes et ouvriers internationaux, il a affirmé : « Les partis, grands ou petits, sont indépendants et égaux, et en même temps unis et unanimes dans leur entraide. »
Il a également clarifié le lien entre aide internationale et autonomie : « Nos pays amis, en premier lieu l’Union soviétique et la Chine, ont fait de leur mieux pour nous aider avec altruisme et générosité, afin que nous puissions bénéficier de meilleures conditions pour devenir autonomes. » Pour renforcer la solidarité et la coopération internationale, nous devons d’abord promouvoir l’indépendance et l’autonomie : « Une nation qui n’est pas autonome mais qui attend l’aide d’autres nations ne mérite pas l’indépendance. »
L'indépendance et l'autonomie sont des valeurs fondamentales et constantes de l'idéologie d'Ho Chi Minh. Le principe fondamental de cette idéologie est : « Si vous voulez que les autres vous aident, aidez-vous d'abord vous-même. » Maintenir l'indépendance et l'autonomie est à la fois une ligne directrice et un principe immuable de l'idéologie d'Ho Chi Minh.
Tirant les leçons des négociations de Genève, le Vietnam a mis en avant la leçon d'indépendance et d'autonomie lors de la négociation de l'Accord de Paris, qui constitue l'idéologie fondamentale de la politique étrangère de Hô Chi Minh. C'est également cette autonomie stratégique qui fait actuellement l'objet de discussions enthousiastes de la part des chercheurs internationaux.
1. Lieutenant-général principal, professeur Hoang Minh Thao « La victoire de Dien Bien Phu avec la Conférence de Genève », livre Accord de Genève 50 ans de revue, Maison d’édition politique nationale, Hanoi, 2008, p. 43.
Source : https://baoquocte.vn/tu-geneva-den-paris-ve-van-de-tu-chu-chien-luoc-hien-nay-213756.html







![[Photo] Le secrétaire général To Lam assiste au 80e anniversaire de la diplomatie vietnamienne](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)









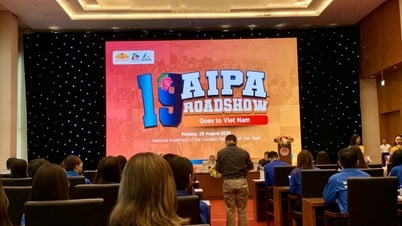











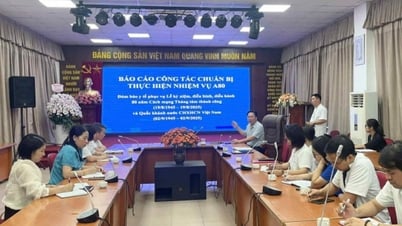
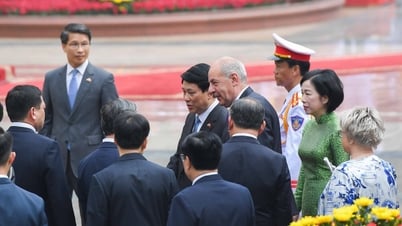






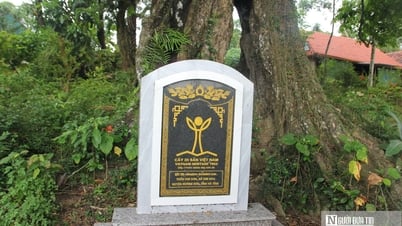









































































Comment (0)