Moustapha et Yu ont mené une étude quantitative auprès de 35 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et ont constaté qu’une augmentation de 1 % des dépenses en recherche et développement (R&D) peut contribuer à une augmentation de 2,83 % de la croissance réelle du PIB, démontrant ainsi le rôle central de l’innovation dans la croissance économique à long terme.
Selon les statistiques de la Banque mondiale , en 2024, au Vietnam, le ratio des dépenses de R&D par rapport au PIB est passé de 0,3 % en 2013 à 0,43 % en 2021. Il s'agit d'une avancée positive, mais toujours faible par rapport à la moyenne des pays développés (généralement comprise entre 2 % et 4 % du PIB).
Le Vietnam est toujours confronté à de nombreux défis tels que les limites dans l’adoption et la maîtrise des technologies, le manque de liens entre les entreprises et les universités et l’exploitation inefficace des ressources intellectuelles mondiales.
AVSE Global (Vietnam Science and Expert Organization Global) est une organisation à but non lucratif basée à Paris, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Ninh Binh pour organiser le Forum de recherche et développement du Vietnam 2025 (Vietnam R&D Forum - VRDF 2025) avec le thème : « Promouvoir l'avenir du Vietnam grâce à des investissements stratégiques en R&D ».
Cet événement devrait constituer une étape stratégique pour promouvoir la transition vers une économie fondée sur la connaissance, tout en renforçant la capacité d’innovation endogène – un facteur clé pour le développement durable et l’amélioration du statut national.
VietNamNet a interviewé M. Hamilton Mann au sujet de la stratégie de R&D au Vietnam. Expert international en technologies, M. Hamilton est actuellement vice-président du groupe Thales, où il codirige le programme mondial de transformation numérique et d'IA du leader mondial de la défense, de l'aérospatiale et de la cybersécurité.

À qui et à quoi sert la R&D ?
Monsieur Hamilton Mann, quels sont les éléments fondamentaux pour établir un mécanisme de connexion durable et à long terme entre les parties prenantes de l’écosystème de la R&D – telles que l’État, les entreprises, les instituts/écoles et la communauté internationale ?
Ce qui compte, ce n'est pas l'objectif de la R&D, mais la réponse à une question plus fondamentale : à qui la R&D est-elle destinée et dans quel but ? C'est le premier élément fondamental : la finalité de la R&D doit être repensée, non pas comme une motivation intrinsèque, mais comme un point d'ancrage.
La R&D doit être conçue comme un modèle de plateforme – une structure permettant la création de valeur dans de multiples dimensions. Dans cette logique de plateforme, le point de départ de toute activité de R&D technologique est essentiellement une « R&D idéologique » : c'est-à-dire une question délibérée : pourquoi l'innovation est-elle nécessaire et à qui sert-elle ?
Chaque groupe – des agences gouvernementales aux entreprises privées, en passant par le monde universitaire et la société civile – a ses propres priorités, contraintes et capacités. L’objectif n’est pas d’homogénéiser, mais de créer un environnement où les différentes contributions enrichissent la trajectoire globale, produisant des résultats supérieurs à ceux que chacun pourrait obtenir isolément.
Cependant, la volonté et l'inclusion ne suffisent pas. Le deuxième facteur fondamental réside dans les mécanismes de soutien. Pour que le modèle de plateforme de R&D se développe, les parties prenantes doivent surmonter deux obstacles principaux : les coûts d'accès – incluant l'information, le financement, l'infrastructure et les partenaires ; et les coûts de transaction – incluant les obstacles juridiques, techniques, culturels et organisationnels qui entravent la confiance, la coordination et la mise en œuvre.
Ces mécanismes permettent non seulement l’accès, mais garantissent également la stabilité, l’interopérabilité et la responsabilité.
En bref, deux éléments – des objectifs communs et des mécanismes systémiques – constituent le fondement du développement d’un écosystème de R&D durable.
D’après votre expérience en Europe et au MIT, existe-t-il des modèles typiques de coopération en R&D dont le Vietnam peut s’inspirer pour développer des partenariats stratégiques à long terme ?
L’Europe et le MIT proposent tous deux des modèles de R&D qui ne sont pas destinés à être copiés, mais à en tirer des principes qui peuvent être ajustés au contexte, ce qui est particulièrement utile pour les pays qui construisent des écosystèmes d’innovation et souhaitent affirmer leur position dans la chaîne de valeur mondiale comme le Vietnam.
Modèle Fraunhofer (Allemagne) : Le modèle Fraunhofer se distingue par son système de financement hybride : environ 30 % proviennent du budget de l'État et 70 % de contrats de recherche appliquée avec des entreprises. Les instituts Fraunhofer sont souvent étroitement liés aux pôles industriels locaux, ont une mission claire et se concentrent sur l'innovation commerciale.
La leçon pour le Vietnam : non pas dans le modèle organisationnel, mais dans le principe – lier la capacité de recherche à la mission de service à l’industrie, en partageant la propriété et les risques.
Modèle EIT & KIC (Europe) : Les Instituts européens d'innovation et de technologie (EIT) et les Communautés de la connaissance et de l'innovation (KIC) sont des réseaux publics-privés-académiques à l'échelle européenne autour de grands défis sociétaux tels que le climat, la santé, les transports, la digitalisation…
Ce modèle permet à la fois l’expérimentation locale et l’apprentissage au niveau du système.
Le Vietnam peut appliquer cette logique pour construire des centres d’excellence régionaux, non seulement seuls mais comme base pour développer des écosystèmes autour de missions nationales telles que l’infrastructure numérique, l’agriculture intelligente ou l’adaptation au changement climatique.
Programme de liaison industrielle du MIT (ILP) : Plus qu'une simple mise en relation des entreprises avec les professeurs, l'ILP conçoit des relations stratégiques à long terme entre les entreprises mondiales et l'écosystème d'innovation du MIT, y compris les startups, les spin-offs et les laboratoires appliqués.
MIT Jameel World Education Lab (J-WEL) : Ce programme s'associe aux gouvernements, aux universités et aux fonds de développement des pays en développement pour co-créer des capacités d'innovation, plutôt que de simplement les transférer. Il se distingue par son engagement à long terme et son orientation vers le renforcement des capacités institutionnelles.
Le Vietnam, avec son penchant pour l’investissement dans l’éducation et la transformation numérique, pourrait bien bénéficier de ce modèle, sous la forme de programmes pluriannuels de développement des capacités qui visent à construire plutôt qu’à exploiter.
La politique aide les idées à mûrir et à devenir des « signaux d’investissement »
L'un des obstacles les plus courants dans les pays en développement est le fossé entre la recherche et le marché. Comment voyez-vous le rôle des politiques publiques dans la promotion du transfert et de la commercialisation des résultats de la recherche au Vietnam ?
L'écart entre la recherche et le marché est souvent interprété à tort comme un manque de technologie ou d'esprit d'entreprise. Il s'agit en réalité d'un manque de conception : une incapacité à aligner la motivation, les capacités et le calendrier de l'écosystème de la recherche sur l'écosystème du marché.
C’est là que les politiques publiques ont un rôle crucial à jouer, non seulement en matière de financement, mais aussi en établissant les conditions pour que le transfert devienne une norme durable et crée de la valeur.
Les politiques publiques doivent intervenir à trois niveaux intégrés :
Cadre de mission : Par exemple, les centres Catapult au Royaume-Uni, financés par le gouvernement pour mener des missions industrielles stratégiques (fabrication avancée, énergie, médecine cellulaire, etc.), ne sont pas axés sur les résultats, mais sur les objectifs : ils aident les entreprises à comprendre « pour qui » et « pour quoi » elles doivent s’engager dans la R&D.
Construire une plateforme – réduire les frictions systémiques : VTT, en Finlande, en est un exemple frappant. Il s'agit non seulement d'un institut de recherche, mais aussi d'un intégrateur neutre entre le monde universitaire et l'industrie. L'institut met à disposition des laboratoires partagés, soutient le transfert de propriété intellectuelle et la coordination des projets, réduisant ainsi les coûts d'accès et de transaction.
Renforcer les capacités – combler le manque d'intermédiaires : Un obstacle majeur dans les pays en développement est le manque d'institutions et de compétences intermédiaires capables de transformer les résultats de la recherche en modèles économiques, prototypes ou stratégies juridiques. Prenons l'exemple d'Israël : l'Autorité israélienne de l'innovation (IIA) finance non seulement la R&D, mais investit également dans des bureaux de transfert de technologie, des programmes de test d'idées, des incubateurs publics-privés, etc.
La politique ici est d’aider les idées à mûrir en « signaux d’investissement » – c’est la couche de valeur clé que le Vietnam doit construire.
En bref, les politiques publiques doivent être conçues comme le ciment entre la science, les marchés et la société, non seulement par le biais du financement, mais aussi par le biais de normes, d’infrastructures partagées, d’incitations et de légitimité sociale.
Les politiques publiques doivent créer une architecture pour la R&D : orientation, réduction des frictions, renforcement des capacités. La commercialisation ne sera alors plus un goulot d’étranglement, mais un moteur stratégique de création de valeur nationale.
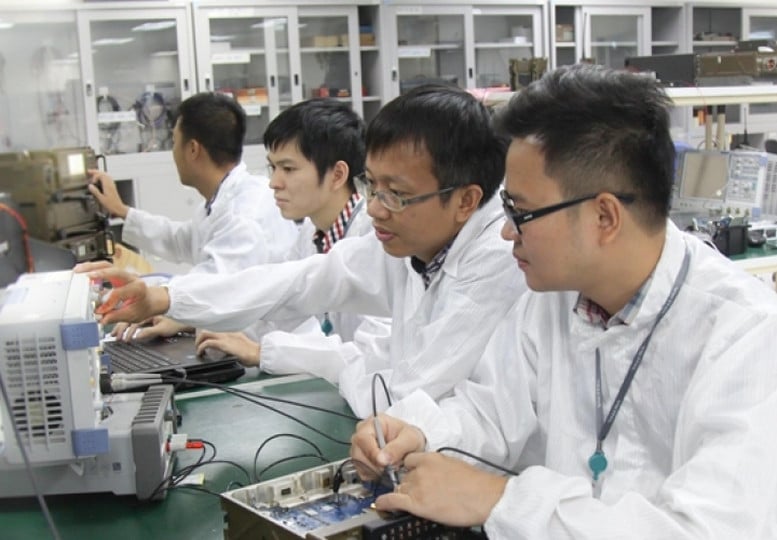
Pour que les entreprises ne soient plus des « bénéficiaires », mais des partenaires d’apprentissage
Dans l'écosystème de l'innovation, les entreprises sont souvent des « acheteurs de connaissances ». Selon vous, comment le secteur privé vietnamien pourrait-il participer plus activement aux investissements en R&D et exploiter les résultats de la recherche universitaire ?
Tout d’abord, je voudrais remettre en question le concept même d’« acheteur de connaissances ».
Considérer les entreprises comme des « acheteurs de connaissances » reflète une vision transactionnelle de l’innovation, où le monde universitaire produit et l’industrie consomme. Mais en réalité, l’innovation ne résulte pas d’un simple transfert de connaissances, mais de la coévolution des connaissances et de la demande.
Cela exige que le secteur privé non seulement absorbe la recherche, mais aussi qu’il façonne de manière proactive les conditions pour que la recherche soit pertinente, applicable et évolutive.
Au Vietnam, cela signifie placer les entreprises au cœur de l'écosystème de l'innovation. Il ne s'agit pas seulement d'apporter des financements lorsque cela est opportun, mais de participer dès le début, d'intégrer les compétences et de co-développer le parcours d'innovation.
Modèle danois : GTS Institute of Advanced Technology : Cet institut sert d'intermédiaire pour la R&D appliquée entre les universités et les petites et moyennes entreprises (PME). Sa force réside dans le fait que les entreprises, notamment les moyennes, mutualisent leurs capitaux dans des plateformes technologiques qu'elles ne pourraient développer seules. Les entreprises ne se contentent pas d'« acheter » la recherche, mais identifient conjointement les problèmes, testent des solutions et réduisent les risques liés à l'innovation.
Il s’agit d’un modèle efficace pour les entreprises vietnamiennes afin de répondre de manière stratégique aux besoins de recherche appliquée, en particulier dans des domaines essentiels tels que l’agriculture de haute technologie, la logistique, la fabrication verte, etc.
Modèle de Singapour : l'initiative d'accès à la technologie d'A*STAR : ici, les entreprises - en particulier les petites et moyennes entreprises - ont accès à des laboratoires et à des équipements de pointe à des prix préférentiels soutenus par le gouvernement, ainsi qu'à des conseils techniques, des tests d'échantillons, des formations... La recherche n'est plus un « luxe » mais est devenue une « rampe de lancement de capacité » pour les entreprises.
Dans ce modèle, le secteur privé intègre les problèmes pratiques, les besoins de développement de produits et les objectifs d'innovation au système, devenant ainsi un co-déterminateur des programmes de R&D appliquée, plutôt que d'attendre passivement que les résultats académiques « coulent ».
Ils ne sont plus des « bénéficiaires », mais des partenaires d’apprentissage, des multiplicateurs des actifs nationaux de R&D, transformant l’infrastructure de recherche en une plateforme de compétitivité à long terme.
Le changement stratégique le plus important réside dans l’état d’esprit : développer les talents, instaurer la confiance et une vision à long terme sont tout aussi importants que les droits de propriété intellectuelle.
Les entreprises doivent dépasser la mentalité du « retour sur produit » pour se concentrer sur le « retour sur participation », qui inclut les personnes, la collaboration et les facteurs écosystémiques.
Lorsque les entreprises deviennent non seulement des « acheteurs de connaissances » mais des « créateurs de connaissances », elles accélèrent non seulement leur propre innovation mais élèvent également la capacité créative nationale dans son ensemble.
* Partie 2 : L'investissement en R&D doit être lié à la « mission nationale »
Hamilton Mann est un expert international en technologie, auteur à succès et actuellement vice-président du groupe Thales, où il codirige le programme mondial de transformation numérique et d'IA pour la première entreprise mondiale de défense, d'aérospatiale et de cybersécurité.
Il est maître de conférences à l'INSEAD et à HEC Paris, et doctorant en intelligence artificielle à l'École des Ponts – Institut Polytechnique de Paris. Hamilton est également consultant au Priscilla King Gray Center (MIT) et Senior Fellow au Retech Center (France).
En 2024, il a été honoré par Technology Magazine comme l'un des 10 meilleurs penseurs mondiaux de la technologie, sélectionné pour Thinkers50 Radar, et en 2025, il a reçu le titre de Digital & AI Leader for Humanity par Who Is Who International Awards.

Source : https://vietnamnet.vn/khi-doanh-nghiep-khong-chi-la-nguoi-mua-ma-la-nguoi-kien-tao-tri-thuc-2426559.html







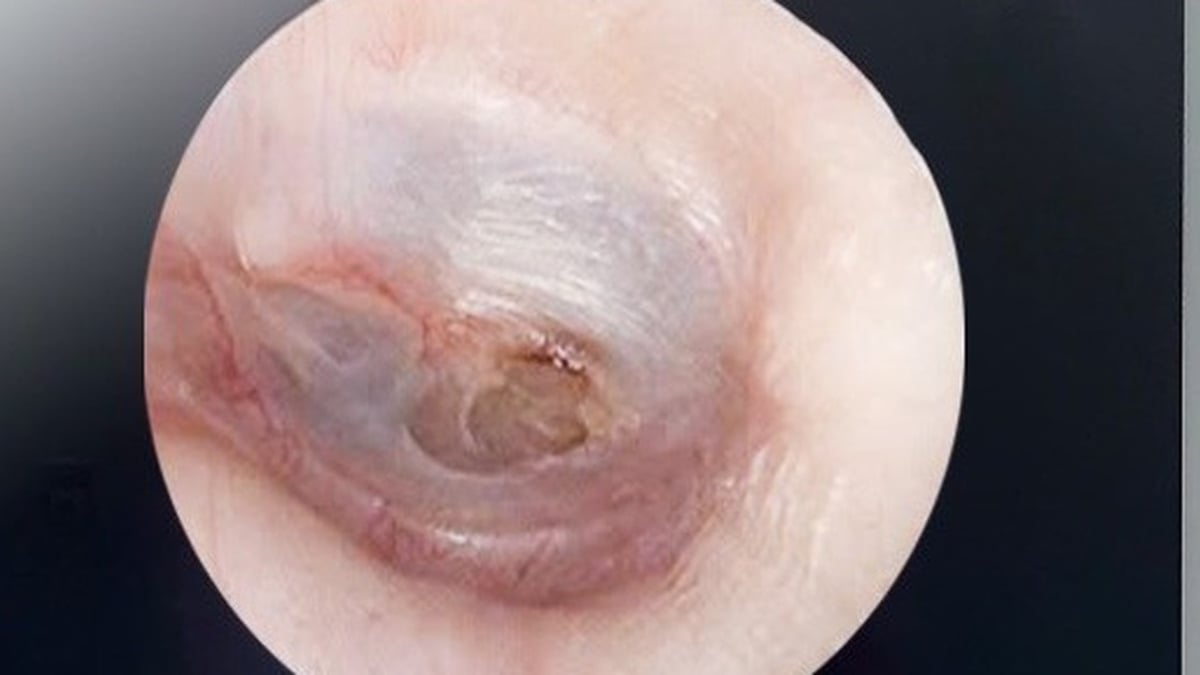
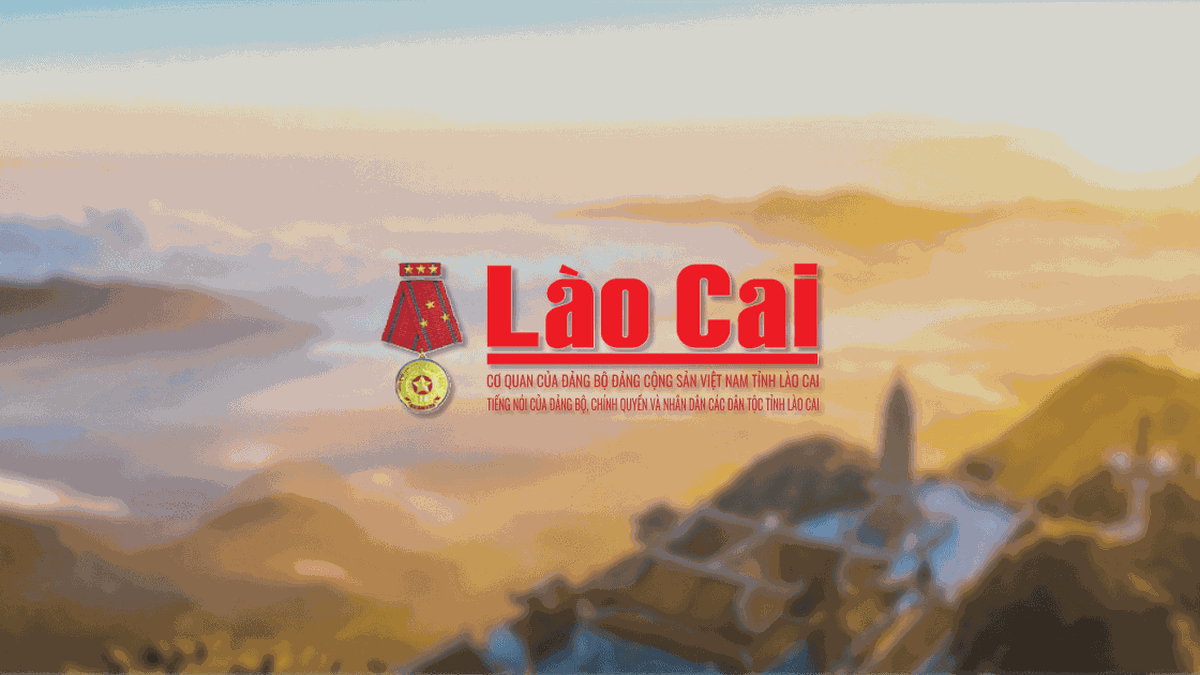




















![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale participe au séminaire « Construire et exploiter un centre financier international et recommandations pour le Vietnam »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/28/76393436936e457db31ec84433289f72)























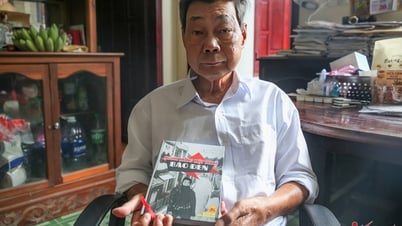


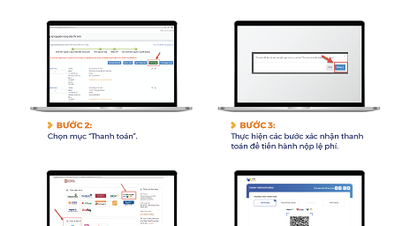








































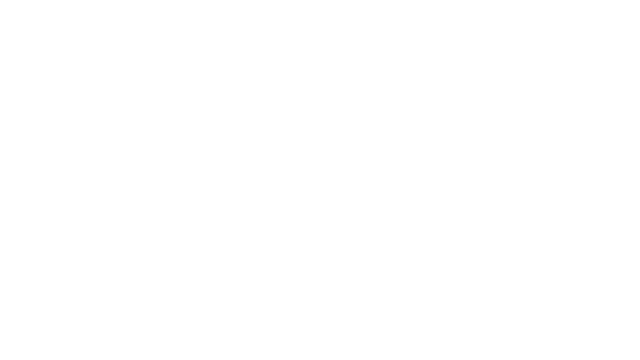

Comment (0)