
Ma maison était nichée au milieu d'un jardin d'arecs, avec un toit bas en tuiles qui semblait s'incliner devant la montagne. Les murs étaient faits de boue mélangée à de la paille ; à la saison des pluies, l'eau s'infiltrait et, à la saison sèche, ils se fissuraient. Mais c'est là que j'ai découvert pour la première fois l'odeur chaleureuse de la famille, là où les repas étaient maigres mais où l'affection familiale était omniprésente.
Ma mère était douce et patiente. Chaque matin, elle allait au jardin, encore sombre, arrosant avec empressement chaque rangée de légumes et secouant chaque feuille de chou vermoulue. À midi, elle dormait peu, s'asseyant souvent pour m'éventer afin que j'étudie, marmonnant et comptant les pièces que ma mère gagnait en vendant des légumes tôt le matin. Comment oublier les traversées quotidiennes en ferry, où ma mère travaillait dur pour vendre et nous élever, mes frères et sœurs et moi, dans l'éducation.
Enfant, je n'avais pas beaucoup de jouets. Mes jouets quotidiens étaient le sable de la berge, les cerfs-volants que mon père fabriquait en papier ciment et le son d'une flûte en bambou désaccordée par le vent.
Je ne me souviens plus quand j'ai commencé à me sentir triste. Peut-être était-ce un après-midi d'hiver, lorsque le troupeau de canards que mon père élevait fut emporté par l'inondation. Mon père resta assis en silence tout le temps, sans dire un mot. Plus tard, chaque fois que je retournais dans ma ville natale, me tenant au bord de la rivière, et que je me remémorais l'image de mon père à cette époque, assis près de la faible lampe à huile pour couper les jeunes feuilles de mûrier afin de nourrir les vers à soie la nuit, mon cœur se serrait, incapable de retenir mes larmes.
Dans mon rêve, je me voyais voler très haut, contemplant un petit village aussi petit qu'une main, la rivière scintillante telle une écharpe déployée sur mes souvenirs. Mais à mon réveil, je n'étais plus qu'un enfant assis, les genoux repliés, regardant par la fente de la porte, écoutant le vent siffler à travers les bambous comme une menace.
Plus je vieillis, plus je comprends que le rêve de voler ne peut me sauver de cette terre. Seuls les souvenirs, douloureux ou doux, me rappellent que j'y suis allé un jour, que j'y ai vécu, ri et pleuré avec mon village.
Chaque vie humaine est un fleuve, et chaque fleuve a une source. Ce sentiment m'a habité tout au long de mes pérégrinations, et il persiste particulièrement dans mes œuvres ultérieures, telle une malédiction : ma source, c'est mon père, instituteur de village, bref, mais profond. C'est ma mère, une pauvre femme aux cheveux blancs, alors que je n'étais pas encore une personne. C'est le chant des cigales au début de l'été, l'odeur de l'eau boueuse du puits après la pluie, l'ombre des bambous appuyés sur les pages blanches de mes cahiers d'écolier d'enfance, c'est la rivière Vu Gia, érodée d'un côté et sédimentée de l'autre, entourée de montagnes sur trois côtés, verdoyante sur les quatre…
Chacun a sa propre façon de « retourner aux sources » à travers les souvenirs et la nostalgie de son enfance vécue et portée en lui toute sa vie. Bien des années plus tard, alors que je vivais en ville, passant devant de grands immeubles, me reflétant sur des surfaces vitrées inconnues, j'entendais encore parfois le léger bruissement des rames au petit matin. Ce n'est qu'alors que je réalisai que je n'avais jamais quitté cet endroit : « Ce village est parti avec moi/à mon insu/Si seulement, au milieu du poème que j'ai écrit/l'ombre de la rivière et des montagnes scintillait/J'habitais au village/Maintenant, le village vit en moi. »
Source : https://baoquangnam.vn/neo-lai-que-nha-3157185.html

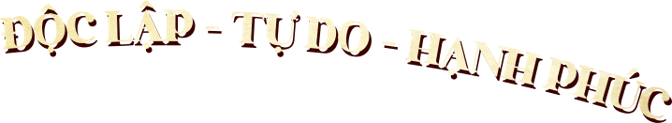




































































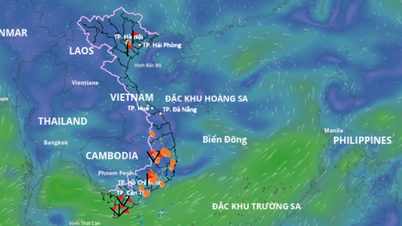




































Comment (0)