À l'aube de 2025, face à la situation sur le terrain, aux confrontations géopolitiques et aux messages de toutes parts, l'opinion publique débat abondamment du gel de la guerre et des solutions pour mettre fin au conflit en Ukraine. Quelle est la vérité et est-ce réalisable ? Cherchons une réponse auprès de toutes les parties concernées.
L'Ukraine, céder ou ne pas céder
Avec un fort soutien militaire , économique, politique et diplomatique et l'implication de l'Occident, en 2024, Kiev a également fait beaucoup de choses, ne permettant pas à la ligne de défense orientale de s'effondrer, occupant la majeure partie de la province de Koursk pendant de nombreux mois et attaquant avec des missiles et des drones un certain nombre de cibles au plus profond du territoire russe.
 |
| Sous la pression de plusieurs côtés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a pu s'empêcher d'évoquer la possibilité d'accepter la perte temporaire d'une partie de son territoire. (Source : AFP) |
Les atouts du président Volodymyr Zelensky sont la « menace pour la sécurité européenne émanant de Moscou », le rôle de Kiev comme « guerrier du flanc oriental » et la vanne du pipeline destiné au transport du pétrole et du gaz depuis la Russie. Kiev dépend de plus en plus du soutien des États-Unis et de l'Occident. De son côté, l'UE est également contrainte de s'impliquer dans le conflit ukrainien, où elle est également prise en otage.
L'afflux rapide d'argent et d'armes en provenance des États-Unis et de l'UE permettra à Kiev de poursuivre la guerre encore un certain temps, mais la situation ne devrait pas s'améliorer par rapport à 2024. Il est particulièrement difficile de renverser la situation largement défavorable sur le terrain. La solution la plus probable est de tenter de ne pas perdre les négociations, en espérant disposer de plus de temps pour améliorer la situation, puis d'envisager la suite.
En Ukraine, des idées de paix et de changement de dirigeant sont évoquées, ouvrant la voie à une solution politique et diplomatique . Mais actuellement, personne n'est capable de porter le drapeau et de rassembler les forces vives.
Sous la pression de plusieurs parties, le président Zelensky n'a pu s'empêcher d'évoquer la possibilité d'accepter une perte temporaire de territoires (contrôlés par la Russie et difficiles à reconquérir militairement par l'Ukraine) afin de geler le conflit. Kiev a toutefois posé deux conditions préalables : l'OTAN garantissait la sécurité en admettant l'Ukraine comme membre et en envoyant des troupes de surveillance.
La Russie n'acceptera certainement pas la moindre de ces exigences. Certains membres de l'OTAN se sont également abstenus de voter en sa faveur. Kiev a donc fait des concessions qui sont pratiquement nulles ou qui vont progressivement abaisser la barre. La question fondamentale reste la même. La balle est dans le camp de l'Occident.
Le dilemme et le calcul occidentaux
Avec autant d'armes et d'argent injectés en Ukraine, l'Occident et l'OTAN ne renonceront pas facilement à l'opportunité de se rapprocher et d'utiliser les autres pour affaiblir la Russie. À partir du 1er janvier 2025, ce sera au tour de la Pologne d'assurer la présidence tournante du Conseil de l'UE. Le président polonais Andrzej Duda, qui s'est engagé à porter le budget de la défense à 4,7 % du PIB et à en consacrer 35 % à l'achat d'équipements militaires américains, mènera l'UE dans une direction ferme, déterminée à renforcer le « bouclier oriental » et les relations transatlantiques.
Les « locomotives » allemandes et françaises montrent des signes de déraillement ; il n'existe pas de consensus au sein du groupe sur un soutien sans réserve à l'Ukraine et une séparation de la Russie du « vieux continent ». Certains États membres sont confrontés à des conflits d'intérêts, notamment le blocus des exportations de céréales ukrainiennes et la fermeture stricte des vannes des pipelines par Kiev… La sécurité alimentaire et énergétique est encore aggravée par le changement climatique.
L'UE est confrontée à un dilemme : incapable de renoncer, elle peine à concentrer tous ses efforts sur la création d'une autonomie stratégique dans une confrontation globale avec la Russie, sans issue en vue. La déclaration du président Donald Trump sur son engagement en faveur de la sécurité et des relations économiques a laissé perplexe l'élite du « Vieux Continent ». D'un côté, les dirigeants européens se sont engagés à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout ; de l'autre, ils envisagent un plan de secours.
Le nouveau propriétaire de la Maison Blanche ne peut que tenir son engagement de mettre fin au conflit en Ukraine. Si les États-Unis parviennent à démontrer leur force, leur leadership et leur domination sur les questions internationales les plus complexes, leur « parapluie » sera plus précieux. L'idée du 47e président est de combiner le « bâton » (soutien, renforcement de l'implication militaire et économique) et la « carotte » (levée progressive des sanctions). Cependant, l'important est la réaction de la Russie.
| Le 7 janvier, le président élu américain Donald Trump a annoncé lors d'une conférence de presse dans la station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride que le conflit russo-ukrainien prendrait fin dans les 6 mois. |
Ce que la Russie veut et peut faire
Moscou a tiré les leçons des accords de Minsk II signés le 12 février 2015 entre les Quatre de Normandie, il n'est donc pas facile de tomber dans le piège du « gel des conflits » calculé par l'Occident.
La Russie souhaite réellement mettre fin au long et coûteux conflit par une « solution globale » avec les États-Unis et l’OTAN, comme elle l’a déclaré lors de l’ouverture de l’opération militaire spéciale et du projet d’accord de paix conclu à Istanbul, en Turquie, en avril 2022.
Compte tenu de la situation actuelle et des événements, Moscou ne souhaite pas baisser ses exigences, notamment la reconnaissance du nouveau statu quo. Il en va de même pour l'avenir de relations normales, indissociables et égalitaires entre la Russie et l'UE, l'Occident et les États-Unis.
 |
| Le président russe Vladimir Poutine assiste à une veillée aux chandelles et à un service de prière marquant Noël selon le calendrier orthodoxe russe à la cathédrale Saint-Georges sur la colline Poklonnaïa à Moscou, le 6 janvier. (Source : Reuters) |
Désormais, la Russie continuera d'accroître sa présence militaire sur le front, en Ukraine, et de restaurer complètement Koursk, envoyant ainsi un message fort aux États-Unis, à l'Occident et à l'OTAN, créant ainsi la position la plus avantageuse pour accepter de s'asseoir à la table des négociations. Le pays du bouleau est-il assez fort pour ce calcul ?
Il y a des inquiétudes quant à la force de la Russie : pas assez forte pour lancer une attaque massive, porter un coup décisif, briser rapidement la ligne de défense, détruire un grand nombre de forces et de véhicules ukrainiens, restaurer Koursk et ne pas permettre aux missiles et aux drones de l'adversaire d'agir librement...
Penser ainsi, c'est méconnaître l'art de la guerre et la nature du conflit russo-ukrainien. Le territoire russe est trop vaste, la ligne de front s'étend sur plus de 1 000 km. Combien de soldats et d'armes sont nécessaires pour constituer une force supérieure et protéger l'arrière ? La puissance de feu de Moscou vise à attaquer avec précision, et non à semer la zizanie comme l'ont fait les États-Unis et l'Occident au Kosovo, pendant la guerre du Golfe…
Le plus important est que le pays du bouleau doit faire face au soutien en armes, en finances, en équipes de conseil, en experts militaires, en systèmes de renseignement militaire, en reconnaissance par satellite, en navigation spatiale... de nombreux pays membres de l'OTAN et de l'Occident.
Imaginez si la Russie concentrait tous ses efforts sur le front ukrainien, laissant ses défenses arrière vides, et que l'OTAN s'approchait de la frontière, resterait-elle immobile ? Bien qu'il existe encore des limites, Moscou s'efforce de maintenir cette position.
Pas difficile et très difficile
Malgré leurs divergences d'opinions, toutes les parties concernées envisagent une solution au conflit en Ukraine. Il est donc compréhensible que 2025 suscite des espoirs. La difficulté est de savoir comment et quand.
Si les États-Unis et l'Occident cessent leur soutien et leur engagement, le conflit prendra fin tôt ou tard. Mais c'est impossible. Le plus difficile, le plus grand obstacle, réside dans la contradiction entre les objectifs des parties.
Les États-Unis, l'Occident et l'OTAN ne peuvent pas laisser l'Ukraine « tout perdre » (ce qui signifierait la victoire de la Russie), mais ils ne peuvent pas non plus « couvrir le terrain » indéfiniment, tant que la victoire est lointaine. Ils ne veulent pas non plus affronter directement la Russie dans une troisième guerre mondiale, voire une guerre nucléaire, ce qui implique de ne pas acculer Moscou dans ses retranchements.
Les États-Unis souhaitent que l'UE soit autonome dans sa confrontation avec la Russie, afin de pouvoir traiter librement avec la Chine, mais ils ne veulent pas non plus que leur allié échappe à son protectionnisme et à sa domination coûteux. L'UE aspire également à une autonomie stratégique, mais elle est quelque peu « impuissante ».
 |
| Le président élu Donald Trump a déclaré qu'il donnerait la priorité à la résolution du conflit russo-ukrainien dans les six mois. (Source : Ukrinform) |
La mesure la plus réaliste consiste à geler le conflit, à le surveiller, à suspendre les conditions préalables et à créer un environnement propice au dialogue et aux négociations. L'objectif de l'Occident et de l'OTAN est d'empêcher la Russie de gagner et l'Ukraine de perdre, en créant ainsi le temps et les conditions nécessaires à Kiev pour se redresser et se consolider grâce à un soutien extérieur. Comme analysé précédemment, la Russie ne souhaite pas répéter les accords de Minsk II ; cette mesure est donc assez vague.
On parle et on espère un sommet entre le nouveau chef de la Maison Blanche et le président Vladimir Poutine, considéré comme une avancée décisive. Les deux dirigeants ont discuté de la question ukrainienne dans un esprit de concessions mutuelles.
Un terrain d'entente peut être trouvé si les parties parviennent à un compromis conforme à leurs propres calculs. Lorsque le conflit est dans l'impasse ou approche de ses limites, la négociation apparaît. Le niveau de compromis peut être équilibré ou plus avantageux pour l'une des parties, selon la corrélation, la situation et les calculs.
Donald Trump a beaucoup de travail à accomplir dès sa prise de fonctions officielle, notamment la mise en place de son équipe et de ses conseillers. La réunion, si elle a lieu, aura donc lieu au plus tôt fin janvier.
Le nouvel occupant de la Maison Blanche est déterminé, mais très imprévisible. Le chef du Kremlin est tout aussi déterminé et imprévisible. Ainsi, en 2025, l'occasion pourrait se présenter de discuter d'un gel de la guerre. Accepter cette discussion est difficile, parvenir à un consensus et le mettre en œuvre l'est encore plus.
Une résolution complète du conflit est encore plus lointaine. Difficile à dire.
Source : https://baoquocte.vn/dong-bang-xung-dot-nga-ukraine-nam-2025-hy-vong-va-tinh-kha-thi-300002.html






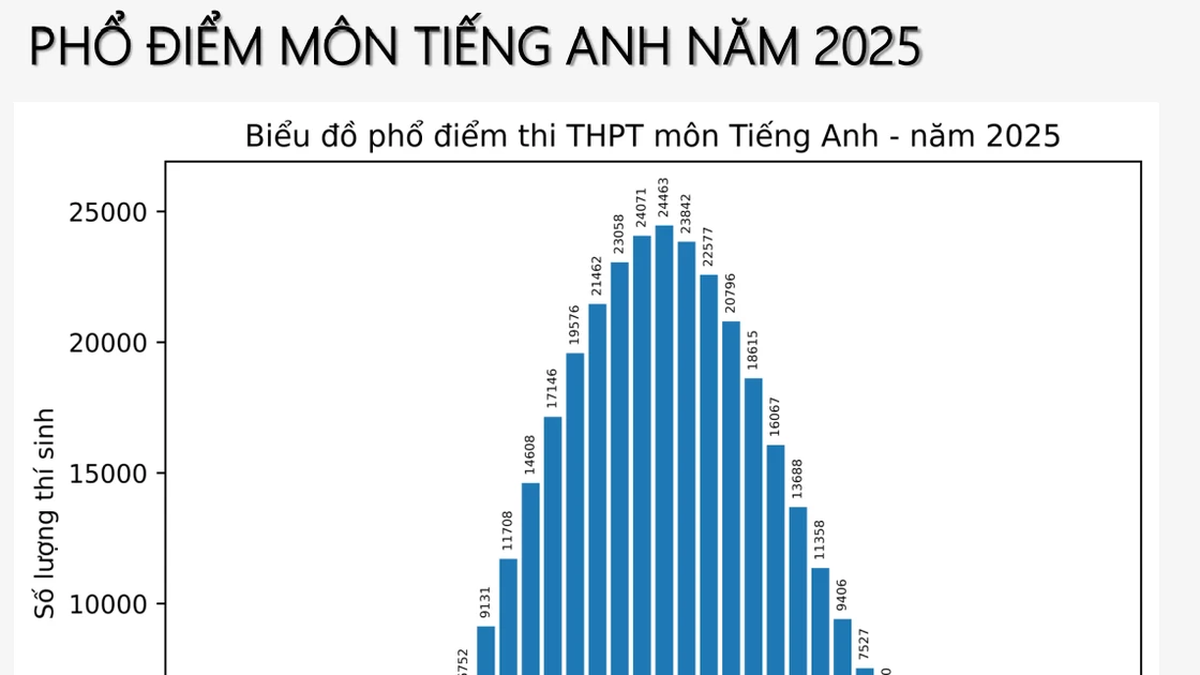








































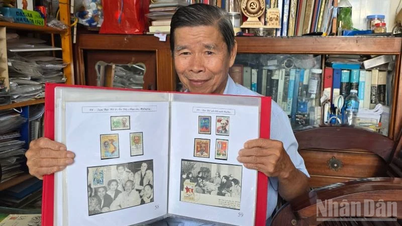





















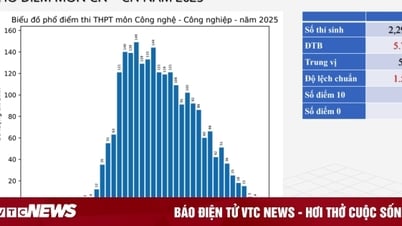
































Comment (0)