Cependant, après près de 10 ans de mise en œuvre, le processus d’application du Code pénal a également rencontré certaines difficultés et lacunes qui nécessitent des amendements et des compléments pour s’adapter à la réalité et protéger les droits humains fondamentaux.
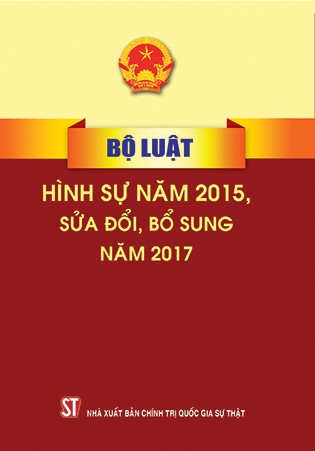 |
| Code pénal 2015 (modifié et complété en 2017). |
Des problèmes surviennent dans la pratique
Face à l'évolution rapide des conditions socio-économiques et des textes juridiques, les criminels cherchent constamment de nouveaux moyens d'échapper à la loi. Le Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) présente certaines difficultés et insuffisances par rapport à la réalité, nécessitant des ajustements appropriés et synchrones avec les autres lois connexes.
Premièrement, les fondements de l’exonération de la responsabilité pénale ne sont pas uniformes et peuvent être interprétés de différentes manières.
L'article 29, clause 3, du Code pénal de 2015 stipule que « Toute personne qui commet un crime moins grave ou un crime grave causant involontairement des dommages à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité ou aux biens d'une autre personne et qui est volontairement réconciliée par la victime ou son représentant et demande l'exonération de sa responsabilité pénale, peut être exonérée de sa responsabilité pénale. »
On peut donc comprendre qu'une personne qui commet un crime moins grave ne peut être exemptée de responsabilité pénale que si elle cause « involontairement » des dommages à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité ou aux biens d'une autre personne et que la victime ou son représentant se réconcilie volontairement et demande l'exemption de responsabilité pénale.
Ou il est entendu qu'une personne qui commet un crime moins grave, causant intentionnellement ou non intentionnellement des dommages à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité ou aux biens d'une autre personne et qui est volontairement réconciliée par la victime ou le représentant de la victime et demande l'exonération de la responsabilité pénale, peut être exonérée de la responsabilité pénale.
Étant donné le manque de clarté de la loi, il est raisonnable de l'interpréter de deux manières. Cependant, cela conduit à une application incohérente du Code pénal, portant atteinte aux droits et intérêts légitimes des suspects et des accusés.
Deuxièmement, la base sur laquelle repose la décision de sanction n’est pas en réalité proportionnelle à la nature et au niveau de danger pour la société et n’est pas adaptée à la personnalité du délinquant.
Conformément à l'article 50, clause 1, du Code pénal de 2015, lors de la décision sur la peine, le jury doit se baser sur les motifs suivants : i) les dispositions du Code pénal de 2015 ; ii) la nature et le niveau de danger pour la société de l'acte criminel ; iii) la personnalité du délinquant ; iv) les circonstances atténuant la responsabilité pénale ; v) les circonstances aggravant la responsabilité pénale.
Les recherches montrent que le Code pénal actuel ne contient aucune disposition spécifique sur la nature et le degré de dangerosité de l'acte criminel pour la société et sur la personnalité de l'auteur. L'évaluation de la nature et du degré de dangerosité de l'acte pour la société repose sur la nature du lien social violé ; la nature de l'acte objectif, y compris la nature de la méthode, des ruses, des outils et des moyens utilisés pour commettre le crime ; le degré de préjudice causé ou menacé de préjudice au lien social violé ; la nature et le degré de la faute ; le mobile et l'objectif de l'auteur ; les circonstances politiques et sociales et le lieu où le crime a été commis.
La réalité au fil du temps montre que la décision du tribunal sur le niveau de la peine est soit trop faible, soit trop élevée, non proportionnelle à la nature et au niveau de danger pour la société du crime et non adaptée à la personnalité du délinquant.
Par conséquent, expliquer clairement les deux bases de décision sur la peine , « la nature et le niveau de danger pour la société du crime » et « la personnalité du délinquant » dans l’article 50 du Code pénal de 2015 garantira les droits légitimes de l’accusé et du défendeur, et limitera la décision sur la peine basée sur la volonté subjective des organes de poursuite.
Troisièmement, les dispositions relatives à l’emprisonnement à durée déterminée pour les personnes de moins de 18 ans font l’objet de nombreuses interprétations et appliquent des peines différentes au même crime.
Si l'on examine le contenu des dispositions de l'article 101 du Code pénal de 2015, l'expression « le niveau d'emprisonnement prévu par la loi » figurant aux articles 1 et 2 donne lieu à de nombreuses interprétations divergentes, appliquant des sanctions différentes au même acte criminel. Plus précisément :
Première voie : s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée, la peine la plus élevée appliquée ne doit pas dépasser les trois quarts (pour les personnes de 16 ans à moins de 18 ans) et ne pas dépasser la moitié (pour les personnes de 14 ans à moins de 16 ans) de la peine d'emprisonnement que la loi prescrit d'appliquer aux personnes de 18 ans ou plus.
Deuxième interprétation : s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée, la peine la plus élevée appliquée ne doit pas dépasser les trois quarts (pour les personnes de 16 ans à moins de 18 ans) et ne pas dépasser la moitié (pour les personnes de 14 ans à moins de 16 ans) de la peine d'emprisonnement la plus élevée prévue par la loi.
Troisième interprétation : s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement à durée déterminée, la peine la plus élevée appliquée ne doit pas dépasser les trois quarts (pour les personnes de 16 ans à moins de 18 ans) et ne pas dépasser la moitié (pour les personnes de 14 ans à moins de 16 ans) de la peine d'emprisonnement la plus élevée prévue par le cadre pénal de la loi.
Quatrièmement, les dispositions relatives à l’encadrement des circonstances dans certaines lois sont déraisonnables.
Français Dans le groupe des crimes contre les biens, le Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017) stipule les circonstances pénales de base dans la clause 1 des articles 172, 173, 174, 175 du Code pénal de 2015 : « Avoir été sanctionné administrativement pour l'acte d'appropriation de biens mais avoir quand même commis l'infraction ; Avoir été condamné pour ce crime ou pour l'un des crimes spécifiés aux articles 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 290 du Code, sans avoir encore de casier judiciaire effacé mais avoir quand même commis l'infraction ».
Toutefois, la clause 2 (cadre aggravé) de chacun de ces quatre articles (articles 172, 173, 174, 175 du Code pénal actuel) stipule la base de la « récidive dangereuse », ce qui conduit à un chevauchement avec la clause 1 (cadre de base).
Cinquièmement, il n’existe aucune réglementation sur la responsabilité pénale des actes visant à troubler l’ordre public ou à terroriser autrui pour recouvrer des dettes.
Actuellement, des cas de déversement d'ordures et de saletés dans les maisons, résidences et propriétés se produisent dans de nombreuses localités, suscitant l'indignation du public. La plupart des cas découverts concernent des opérations de recouvrement de créances.
Cependant, ces actes ne causent pas de dommages aux biens, à la santé ou à la vie des personnes, ne violent pas le domicile des personnes, ne se déroulent pas dans des lieux publics et sont des actes répétés visant à terroriser l'esprit pour recouvrer des dettes ; il n'existe actuellement aucun mécanisme pénal pour les traiter, mais uniquement un traitement administratif conformément aux dispositions du décret n° 144/2021/ND-CP du Gouvernement .
Il est donc nécessaire d'ajouter ce comportement à la Section 4, Chapitre XXI - Autres crimes contre l'ordre public - pour punir sévèrement ces comportements dangereux et protéger les droits et les intérêts légitimes des citoyens.
Sixièmement, la disposition selon laquelle les proches ne sont pas pénalement responsables de la dissimulation de crimes ou de la non-dénonciation de crimes n’est pas véritablement équitable.
Selon les dispositions des articles 18 et 19, celui qui dissimule ou ne dénonce pas un crime est le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, l'enfant, le petit-enfant, le frère ou la sœur, l'épouse ou le mari de l'auteur de l'infraction... et n'est pas pénalement responsable dans certains cas.
Ainsi, si la personne qui dissimule ou omet de signaler est un père adoptif, une mère adoptive, un beau-père, une belle-mère, un enfant adopté, un gendre, une bru, un beau-fils ou une belle-fille de l'épouse, un beau-fils ou une belle-fille de l'époux, un neveu ou une nièce (neveu de nièce, nièce de nièce...) ils ne sont pas soumis aux dispositions des articles 18 et 19, alors qu'ils ont également un lien de parenté étroit et intime comme les personnes énumérées aux articles 18 et 19.
Par conséquent, pour créer une égalité dans le traitement de la responsabilité pénale, il est nécessaire d'ajouter les personnes susmentionnées aux cas de non-responsabilité pénale prévus à l'article 18 (Crime de dissimulation d'un crime) et à l'article 19 (Crime de non-dénonciation d'un crime).
Septièmement, il n’existe pas d’uniformité dans l’application et la gestion du comportement de conduite sous l’influence de l’alcool.
Le point b, clause 2, article 260 du Code pénal actuel augmente le niveau de responsabilité pénale si une personne qui enfreint le règlement sur la circulation routière « consomme de l'alcool ou de la bière et que la concentration d'alcool dans le sang ou dans l'haleine dépasse le niveau prescrit ».
Cependant, l'article 5, clause 6, de la loi de 2019 sur la prévention et le contrôle des dommages liés à l'alcool stipule que l'acte interdit est « conduire un véhicule avec un taux d'alcoolémie ou d'haleine élevé ». Il n'existe donc pas de cohérence entre les dispositions des deux lois, ce qui entraîne des incohérences dans l'application et le traitement des responsabilités légales ; il est donc nécessaire de modifier l'article 260 du Code pénal afin de le rendre conforme à la loi de 2019 sur la prévention et le contrôle des dommages liés à l'alcool et aux autres textes juridiques.
 |
| Photo d'illustration. |
Quelques amendements proposés
Afin de garantir les droits et intérêts légitimes des personnes ainsi que d'être cohérent avec le système juridique vietnamien, de répondre aux changements de pratique, dans le cadre de la recherche visant à contribuer au travail de synthèse, d'évaluation, de modification et de complément du Code pénal de 2015 (modifié et complété en 2017), il existe quelques recommandations de modifications dans les directions suivantes :
Concernant les motifs d'exonération de responsabilité pénale, l'article 29, paragraphe 3, est modifié comme suit : « 3. Toute personne qui commet involontairement une infraction mineure ou une infraction grave portant atteinte à la vie, à la santé, à l'honneur, à la dignité ou aux biens d'autrui, et qui est volontairement réconciliée par la victime ou son représentant et demande son exonération de responsabilité pénale, peut être exonérée de responsabilité pénale. »
Concernant les fondements de la décision de sanction , il est nécessaire d'ajouter des dispositions supplémentaires pour clarifier les deux fondements de la décision de sanction : « La nature et le degré de dangerosité de l'infraction pour la société » et « La personnalité de l'auteur » à l'article 50, clause 1, afin que les autorités de poursuite puissent les appliquer de manière cohérente lors de la détermination de la peine à infliger à l'accusé.
Concernant les dispositions relatives à l'emprisonnement à durée déterminée pour les personnes de moins de 18 ans , il est proposé de modifier l'article 101 du Code pénal afin de supprimer l'expression « le niveau d'emprisonnement prévu par la loi » et de la remplacer par « le niveau d'emprisonnement le plus élevé prévu dans l'échelle des peines prévues par la loi ».
Français Concernant les articles 172, 173, 174, 175. Supprimer la phrase dans la clause 1 « Ayant été reconnu coupable de ce crime ou de l'un des crimes spécifiés dans les articles 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 et 290 du Code, n'ayant pas encore eu son casier judiciaire effacé mais ayant quand même commis l'infraction. » afin d'éviter la duplication avec la circonstance aggravante de « récidive dangereuse » dans la clause 2 des articles ci-dessus.
Il faut ajouter l’acte de « jeter des déchets et de la saleté dans les maisons, résidences et propriétés d’autrui » au délit de trouble à l’ordre public (article 318 du Code pénal actuel) pour empêcher efficacement les sujets de commettre les actes susmentionnés de recouvrement de créances, de pression et de terreur mentale contre les personnes, qui ont provoqué l’indignation publique ces derniers temps.
Ajouter le groupe de parents comprenant « le père adoptif, la mère adoptive, le beau-père, la belle-mère, l'enfant adopté, le gendre, la belle-fille, le beau-fils ou la belle-fille de l'épouse, le beau-fils ou la belle-fille du mari, les neveux et nièces (nièces et neveux de tantes paternelles, tantes paternelles...) » à la clause 2, article 18 (Crime de dissimulation d'un crime) et à la clause 2, article 19 (Crime de non-dénonciation d'un crime) du Code pénal actuel afin d'assurer la cohérence dans le traitement des proches des criminels.
Concernant le délit de violation de la réglementation sur la circulation routière , il est proposé de supprimer l'expression « dépassement du niveau prescrit » au point b, clause 2, article 260, afin de se conformer à la clause 6, article 5 de la loi de 2019 sur la prévention et le contrôle des effets nocifs de l'alcool et de la bière (qui interdit formellement aux conducteurs ayant un taux d'alcoolémie ou d'haleine élevé).
Source : https://baoquocte.vn/sua-doi-bo-luat-hinh-su-bao-dam-quyen-con-nguoi-272907.html
































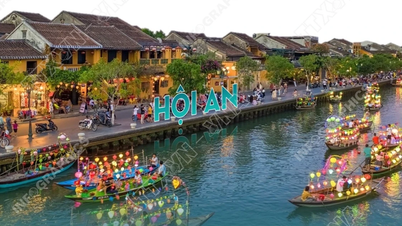


















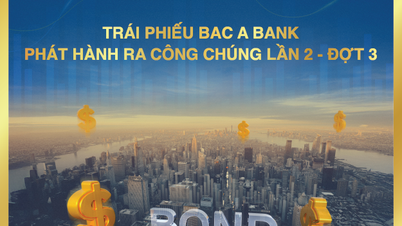









































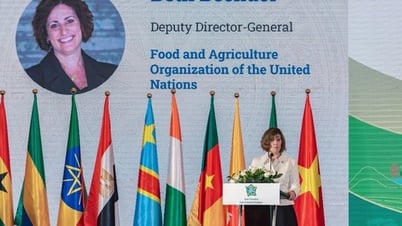







Comment (0)