De nombreux experts et universitaires, malgré leurs points de vue différents, s’accordent sur l’argument selon lequel les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza finiront, tôt ou tard, par se terminer à la table des négociations.
Cependant, jusqu'à présent, le chemin vers la paix demeure ardu et lointain, et on ne sait pas comment résoudre la confusion. Dans ce contexte, il est important de se souvenir de la négociation et de la signature de l'Accord de Genève, il y a exactement 70 ans…
 |
| Des accords de Genève à la réflexion sur la voie de la paix dans le monde d'aujourd'hui. (Source : Getty Images) |
Guerre pour la paix
Si l'on retrace l'histoire du Vietnam jusqu'à la fin du XXe siècle, on constate que presque chaque page est ornée d'images de flèches et de fusils. Ayant traversé de nombreuses guerres de résistance contre les dominations et invasions étrangères, le peuple vietnamien, plus que quiconque, comprend le prix de la paix et aspire toujours à une paix associée à l'indépendance et à la liberté.
Suivant la politique de « paix pour le progrès », le Vietnam signa, le 6 mars 1946, l’Accord préliminaire, acceptant « d’être un pays libre au sein de l’Union française… », et acceptant que 15 000 soldats français remplacent l’armée de Tchang Kaï-chek. Plus de six mois plus tard, pour préserver la paix, le président Hô Chi Minh signa avec le représentant français l’Accord provisoire du 14 septembre, qui comprenait onze dispositions. Les deux parties s’engagèrent à suspendre le conflit ; nous continuâmes à faire des concessions, assurant à la France des avantages économiques et culturels au Vietnam.
Mais la France a quand même envahi le pays. Le Vietnam a dû mener une guerre de résistance de neuf ans. Forts de la situation après la victoire bouleversante de Dien Bien Phu et de notre idéologie d'indépendance et d'autonomie, nous avons néanmoins consenti certaines concessions lors des négociations pour la signature des accords de Genève en 1954 afin d'obtenir un cessez-le-feu et de rétablir la paix. Cet esprit s'est maintenu lors des négociations pour la signature des accords de Paris en 1973, permettant ainsi, deux ans plus tard, d'atteindre l'objectif suprême : libérer le Sud, unifier le pays et construire un Vietnam démocratique, républicain, indépendant, libre et heureux.
Les Vietnamiens ont une chanson touchante : « Bien que nos vies aiment les roses, l'ennemi nous force à tenir les armes. » Pour la paix, nous devons faire la guerre, « la guerre pour la paix ». Mais on ne fait la guerre que lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. En temps de guerre, nous prônons toujours « combattre tout en négociant », ne rater aucune occasion de paix, aussi minime soit-elle ; « se connaître soi-même », « connaître l'ennemi », « savoir avancer », « savoir reculer », etc., en trouvant tous les moyens de mettre fin à la guerre au plus vite, en limitant les pertes humaines pour les deux camps.
L'une des leçons à tirer est que les négociations de paix exigent non seulement une grande volonté et une grande détermination, mais aussi beaucoup de courage et d'intelligence ; à la fois indépendance et autonomie, savoir faire des concessions fondées sur des principes, saisir chaque opportunité, atteindre des objectifs optimaux et concilier l'immédiat et le long terme. Le peuple vietnamien a soif de paix et possède le courage, l'intelligence et l'art nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
Les deux parties ont eu leurs chances, mais les ont manquées. Selon de nombreuses sources (dont le Wall Street Journal ), la Russie et l'Ukraine ont failli parvenir à un accord de paix lors du cycle de négociations de mars 2022 à Istanbul, en Turquie. La clause clé de l'accord stipule que l'Ukraine sera véritablement neutre, limitera la taille de son armée et reconnaîtra la Crimée comme faisant partie de la Russie ; elle pourra adhérer à l'UE, mais pas à l'OTAN… En contrepartie, la Russie retirera ses troupes et rétablira ses relations (ce qui est cohérent avec la déclaration de Moscou lors du lancement de l'opération militaire spéciale).
Selon la même source, Kiev a annulé l'accord à la dernière minute. Certains membres de l'équipe de négociation ukrainienne ont été arrêtés et Kiev a publié un décret interdisant les négociations avec la Russie. Une telle occasion ne se reproduira pas. Si, à ce stade, la Russie et l'Ukraine acceptent de s'asseoir à la table des négociations, les conditions seront bien différentes, bien plus élevées que celles de l'accord manqué, et le prix à payer sera très élevé, pour les deux parties.
La Russie a l'avantage sur le champ de bataille, restant ferme face aux sanctions occidentales, mais il est peu probable que l'issue soit mitigée. Les armes modernes occidentales affluent, poussant l'Ukraine à contre-attaquer avant novembre 2024. Cependant, de nombreux experts et universitaires estiment que Kiev aura du mal à renverser la situation, et que les négociations restent l'option la plus envisageable.
En réalité, la Russie et l'Ukraine parlent toutes deux de négociations. Les précédentes conférences de paix organisées par l'Occident et l'Ukraine ont été essentiellement des instruments de propagande et de rassemblement. Les efforts de médiation de certains pays n'ont produit aucun résultat concret ; rien n'indique que les deux parties soient disposées à s'asseoir ensemble. Quel est le principal obstacle ?
Tout d'abord, les deux parties posent des conditions préalables difficiles à accepter pour l'autre. Il semble qu'une fois lancée, il faille la respecter. Kiev dépend fortement de l'aide financière et militaire, ce qui rend difficile toute prise de décision autonome. Le facteur déterminant sous-jacent est la guerre par procuration complexe entre l'Occident et la Russie. Cela coûte de l'argent, mais entraîner la Russie dans une guerre à long terme qui l'affaiblirait est un prix acceptable. Certains dirigeants occidentaux ne souhaitent pas mettre fin au conflit ; ils souhaitent même entraîner l'OTAN dans une intervention directe. Cette affirmation est étayée par des preuves.
 |
| La conférence de paix sur l'Ukraine, qui s'est tenue en Suisse, a été considérée comme un échec total, car elle n'a pas atteint les objectifs fixés. (Source : wissinfo.ch) |
Aux dernières nouvelles, l'UE a menacé de sanctionner et de boycotter la présidence tournante hongroise, car le Premier ministre Orban s'est montré modéré dans sa politique antirusse, notamment en raison de son rôle actif de « pacificateur » dans le conflit en Ukraine. Il est vrai que le Premier ministre Orban n'a pas sollicité l'avis des dirigeants européens (il s'y opposera certainement). Mais s'il souhaite réellement négocier, l'UE mettra de côté les formalités et agira de concert avec la Hongrie.
L'OTAN et l'Occident étaient tous deux préoccupés par l'élection de l'ancien président Donald Trump. Comme il l'avait annoncé, il limiterait l'aide à l'Ukraine et pousserait Kiev à négocier avec la Russie. L'ancien président de la Maison Blanche ne favorisait pas la Russie, mais souhaitait que l'Europe assume seule la charge, laissant les États-Unis se concentrer sur la gestion de la Chine, son rival systémique et de longue date.
Il s'agit en réalité d'une reconnaissance du rôle des États-Unis dans le conflit ukrainien. On peut dire qu'ils ne souhaitent pas réellement négocier, ou seulement négocier en position de force.
Ainsi, la tenue ou non de négociations ne dépend pas seulement de la Russie et de l'Ukraine. Moscou a clairement indiqué sa volonté de trouver un équilibre entre leurs intérêts pour résoudre le conflit, mais cela doit aller de pair avec la cessation des menaces occidentales contre la sécurité russe. Le facteur majeur, voire décisif, réside dans les intentions stratégiques de l'OTAN et de l'Occident, sous la direction des États-Unis. Par conséquent, les premières négociations pourront « avancer » après l'élection présidentielle américaine, si M. Trump est élu et lorsque l'Ukraine se trouvera dans une situation extrêmement difficile.
Récemment, le New York Times a rapporté que le président Zelensky avait annoncé la tenue d'une deuxième conférence de paix (en novembre), invitant la Russie à y participer pour mettre fin au conflit. Trois conférences seront d'abord organisées sur la sécurité énergétique, la liberté de navigation et l'échange de prisonniers, ouvrant la voie à un sommet.
Mais le 11 juillet, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur la « Sûreté et la sécurité des installations nucléaires », exigeant que la Russie retire « d'urgence » ses troupes de la centrale nucléaire de Zaporijia et la « restitue immédiatement » à l'Ukraine. La Russie considère cette résolution comme néfaste et politisée, et considère l'Ukraine comme la véritable menace pour la sécurité de la centrale. Cela signifie que de nombreuses manœuvres seront déployées pour entraver les négociations jusqu'à leur obtention.
La guerre entre le Hamas et Israël continue
Certains affirment que la situation du Hamas (et de la Palestine) est similaire à celle de l'Ukraine. En réalité, les deux conflits présentent de nombreuses différences. Le rapport de force est en faveur d'Israël, même si le Hamas est soutenu par le Hezbollah, les Houthis et plusieurs autres organisations islamiques armées. Les États-Unis ont proposé un plan de négociation d'un cessez-le-feu, mais ce sont eux, leur principal allié, qui soutiennent sans réserve Israël en matière d'armement, de politique et de diplomatie.
La question est : qui veut réellement négocier un cessez-le-feu et progresser vers une solution pacifique à la question palestinienne ?
 |
| La route vers la paix est encore loin alors que la fumée continue de s'élever dans la bande de Gaza. (Source : AFP) |
Le gouvernement palestinien a longtemps prôné la lutte par des moyens politiques et diplomatiques. Les factions et mouvements palestiniens n'ont pas vraiment trouvé de consensus. Le Hamas a accepté de négocier la libération des otages israéliens, créant ainsi les conditions favorables à un accord-cadre susceptible de mettre fin au conflit. Cette décision est logique, car le Hamas est un peu plus faible.
Les dirigeants israéliens ont accepté de négocier, mais ont continué leurs attaques dans le but d'éliminer le Hamas. Des bombes israéliennes ont touché le siège de l'agence humanitaire des Nations Unies et une école dans la bande de Gaza, tuant et blessant de nombreuses personnes.
La condition la plus fondamentale est la reconnaissance d'un État palestinien indépendant coexistant avec l'État juif, conformément à la résolution des Nations Unies (soutenue par la majorité), mais les États-Unis et certains autres pays y ont opposé leur veto. La commission d'enquête des Nations Unies a déclaré qu'Israël et le Hamas avaient tous deux commis des crimes de guerre, mais Washington est resté silencieux.
Malgré la forte pression internationale, il est probable que Tel-Aviv ne mettra fin à la guerre qu'après avoir éliminé le Hamas et les autres organisations islamiques armées qui n'attaquent pas Israël. Avec son organisation de « guérilla », le Hamas pourrait subir des pertes et perdre temporairement sa position dans la bande de Gaza, mais il est difficile de le détruire complètement : « Perdre une tête en fera pousser une autre ».
La balle des négociations est dans le camp d'Israël et de ses partisans. Pour ces raisons, la guerre entre Israël et le Hamas ne prendra pas fin complètement si les facteurs susmentionnés ne sont pas résolus. Le conflit pourrait s'apaiser temporairement, puis reprendre de plus belle lorsque les conditions seront réunies.
Le chemin vers la paix reste ardu, en raison de l’impact du contexte régional, des calculs des grandes puissances, des étrangers et des conflits profonds et complexes entre Israël et la Palestine.
Source : https://baoquocte.vn/tu-hiep-dinh-geneva-nghi-ve-con-duong-den-hoa-binh-tren-the-gioi-hien-nay-279298.html






















































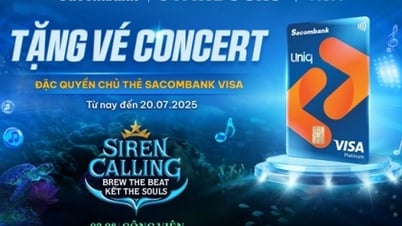







![[Maritime News] Plus de 80 % de la capacité mondiale de transport maritime par conteneurs est entre les mains de MSC et des principales alliances maritimes](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/7/16/6b4d586c984b4cbf8c5680352b9eaeb0)
























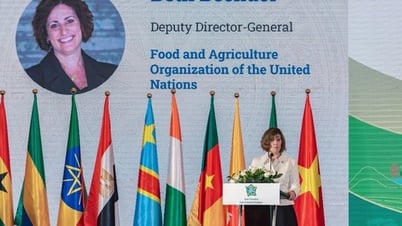













Comment (0)