Pourparlers en Alaska, l'Ukraine au cœur des discussions
Cette évolution intervient dans un contexte de tensions dans les relations entre Moscou et Washington. Fin juillet et début août, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il continuerait de fournir des armes à l'Ukraine et envisagerait de nouvelles sanctions contre la Russie. Ces décisions ont fait craindre que la « lune de miel » entre Moscou et la nouvelle administration américaine ne soit terminée.
Cependant, certains analystes optimistes estiment que les actions du président Trump relèvent davantage de la tactique que de la stratégie à long terme. Leur objectif principal est de faire pression sur l'adversaire pour qu'il fasse des concessions, puis d'ouvrir la voie au dialogue.
Pourtant, peu de gens s'attendaient à ce qu'un sommet, généralement préparé pendant des mois et émaillé de fuites, puisse se tenir aussi rapidement et rester secret. Il est donc possible qu'il s'agisse d'une décision soudaine prise au plus haut niveau, ou que l'ensemble du processus ait été préparé dans le plus grand secret.
Le sujet de l'Ukraine sera certainement au cœur du prochain sommet russo-américain. Tout simplement parce que sans progrès substantiels sur ce dossier, il est politiquement impossible de promouvoir une quelconque coopération bilatérale.
Au cours des six derniers mois, les négociations sur l'Ukraine ont peu progressé. Le président Trump s'est montré de plus en plus impatient, mais est resté inébranlable dans sa détermination. Pour Trump, admettre sa défaite dans le dossier ukrainien constitue non seulement une perte politique, mais aussi personnelle.
La liste des initiatives de réconciliation que le président Trump a promues ou a déclaré vouloir poursuivre, du Congo et du Rwanda à la Thaïlande et au Cambodge, en passant par l’Inde et le Pakistan, Israël et l’Iran, et plus récemment l’Arménie et l’Azerbaïdjan, semble renforcer sa conviction que la diplomatie américaine peut résoudre n’importe quel conflit si elle est déployée correctement.
Mais au-delà des motivations personnelles, une stratégie plus large façonne les décisions de Washington. La Chine et l'Asie étant des priorités stratégiques, l'administration Trump cherche depuis longtemps à réduire sa présence en Europe, notamment dans le conflit ukrainien. Selon Trump, le scénario idéal pour les États-Unis serait que l'Europe gère elle-même ses problèmes, les États-Unis jouant un rôle minimal.
La réalité, cependant, suggère le contraire. Alors que l'OTAN continue d'étendre son rôle et de demander le soutien des États-Unis, un retrait complet devient impossible. La situation observée en Libye semble se reproduire en Ukraine, mais à plus grande échelle et avec un engagement plus important. Les alliés européens ne disposent pas des capacités militaires nécessaires pour soutenir une confrontation à long terme avec la Russie, ce qui entraîne les États-Unis dans le conflit malgré leur volonté de réduire leur implication.
L'Ukraine n'est donc pas seulement un problème régional, mais aussi un point d'étranglement pour la stratégie globale des États-Unis. La résolution du conflit, ou du moins son gel sous contrôle, sera une condition préalable pour que Washington réoriente ses priorités stratégiques vers l'Asie et évite de s'enliser dans une crise prolongée en Europe.
La porte étroite du compromis
Cependant, la voie vers la paix en Ukraine risque d'être entravée par la position inébranlable de Moscou, qui recherche une solution globale, juridiquement contraignante et durable. Pour la Russie, mettre fin au conflit ne se résume pas à un simple cessez-le-feu, mais à l'élimination complète de la menace émanant de l'Ukraine, y compris de son potentiel militaro-technique, ainsi qu'à la résolution définitive des conflits territoriaux.
L'échec du processus d'Istanbul en 2022 est en grande partie dû au refus de Kiev d'examiner des propositions de paix allant dans ce sens. Mais pour la Russie, ces conditions ne sont pas négociables, mais relèvent de considérations vitales de sécurité nationale. Selon Moscou, si l'Ukraine reste sous l'influence occidentale, maintient son potentiel militaire et ne dispose pas d'un accord contraignant pour mettre fin aux combats, le conflit risque de s'intensifier à court terme. Dans ce contexte, toute médiation du président Trump qui ne répondrait pas aux exigences fondamentales de la Russie aurait peu de chances de produire des résultats durables. Washington semble conscient des préoccupations fondamentales de Moscou en matière de sécurité et recherche un compromis. Mais de nombreux obstacles restent à surmonter.
Premièrement, même si le président Trump parvient à convaincre Kiev et ses alliés européens d'une solution, le soutien sera inégal. Tout accord conclu en Alaska risque de se heurter à la résistance de l'Ukraine et de certains pays de l'UE.
Deuxièmement, la position officielle de Washington est que la paix doit être forgée par des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis agissant comme médiateur ou observateur. Cette structure a été adoptée à Istanbul et, si elle se poursuit, la prochaine étape après le sommet devrait être de rétablir le format du dialogue russo-ukrainien, soit dans sa forme originale, soit sous une forme modifiée.
Troisièmement, et peut-être le plus important, il faut se demander dans quelle mesure le président Trump est disposé à accepter les conditions de la Russie. Compte tenu de sa réputation de « négociateur acharné », il est peu probable qu'il accepte pleinement les exigences de Moscou. D'autre part, les dirigeants russes ont pour habitude de ne pas céder sous la pression. Ce sommet constituera donc davantage un test de position qu'un lieu de percées immédiates.
Dans ce contexte, il est difficile de prédire l'issue précise du sommet. Moscou a deux options : réunir les conditions essentielles à une solution politique, ou gagner davantage d'espace et de conditions favorables pour poursuivre la campagne militaire avec le soutien d'un processus de négociation parallèle. Pour le président Trump, l'objectif est d'obtenir un engagement à mettre fin au conflit, même si cela implique d'accepter certains changements de rythme et de conditions. Il a besoin de résultats concrets pour prouver son rôle de « pacificateur », tant aux yeux de ses électeurs nationaux que de la communauté internationale, et il ne peut donc pas quitter la table des négociations les mains vides.
Il est fort probable que les paramètres de faisabilité aient été définis à l'avance lors des contacts préliminaires de l'envoyé spécial Witkoff. Un cessez-le-feu immédiat est donc peu probable. Le scénario le plus réaliste serait que les deux parties s'accordent sur une feuille de route pour les négociations, incluant une nouvelle échéance, un format réorganisé pour le processus de paix et un cadre actualisé pour la configuration finale de la solution. Cependant, même une telle « feuille de route » se heurterait à des obstacles complexes dans sa mise en œuvre et risquerait de s'éterniser.
Hung Anh (Contributeur)
Source : https://baothanhhoa.vn/hoi-nghi-thuong-dinh-nga-my-tai-alaska-co-hoi-hoa-binh-mong-manh-hay-van-co-chien-luoc-257601.htm






![[Photo] La première réunion du Comité de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/f5ed4def2e8f48e1a69b31464d355e12)
![[Photo] Marcher ensemble dans le cœur du peuple](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/8b778f9202e54a60919734e6f1d938c3)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam reçoit le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/5af9b8d4ba2143348afe1c7ce6b7fa04)
![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, accueille et s'entretient avec le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/31/9fa5b4d3f67d450682c03d35cabba711)



















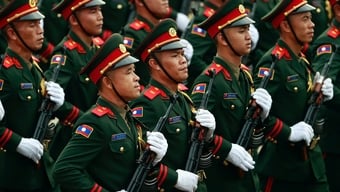
































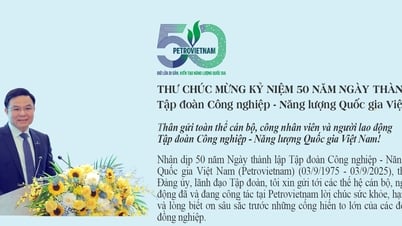














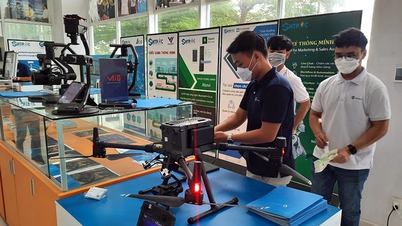








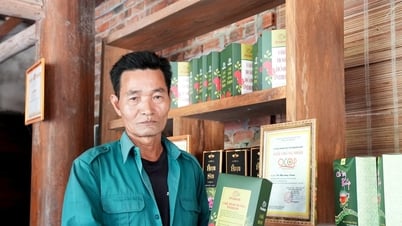










Comment (0)