Dans le système des institutions et croyances religieuses du peuple vietnamien, des structures telles que les maisons communales, les pagodes, les temples et les sanctuaires ont été largement étudiées et sont devenues des symboles familiers dans la conscience communautaire. Cependant, les temples taoïstes, lieux de culte des dieux taoïstes, constituent la pièce manquante de ce tableau général.

Fort de nombreuses années de recherche et d'expérience sur le terrain, le Dr Nguyen The Hung a choisi le territoire à l'ouest de Hanoi (anciennement partie de Xu Doai) comme point culminant pour aborder le système de temples taoïstes tels que le temple Hoi Linh, le temple Hung Thanh, le temple Linh Tien, le temple Lam Duong... Du point de vue de l'histoire religieuse, il a commenté : « L'existence de temples taoïstes dans de nombreux endroits prouve que cette institution religieuse a joué un rôle important dans la vie spirituelle du peuple vietnamien ».
Ce lieu n'est pas seulement un lieu de culte pour des dieux tels que Tam Thanh, Ngoc Hoang et Huyen Thien Tran Vu, mais aussi un lieu où l'on peut observer la cristallisation et l'harmonie entre le taoïsme, les croyances populaires vietnamiennes et d'autres grandes religions comme le confucianisme et le bouddhisme. Selon l'auteur, c'est grâce à cette harmonie que le taoïsme n'est pas une religion purement étrangère, mais qu'il s'est rapidement implanté, intégré et fortement répandu dans la vie spirituelle du peuple vietnamien.
L'une des découvertes remarquables de l'ouvrage est l'évolution de l'architecture des temples taoïstes au fil du temps. Si au XVIe siècle, le plan des temples adoptait souvent la forme de la lettre Tam, au XVIIe siècle, le modèle architectural adopta la lettre Cong, symbole de solidité, d'équilibre et d'introversion. De plus, le système du hall arrière et du clocher, caractéristiques marquantes des temples taoïstes de cette période, est également considéré par l'auteur comme une « passerelle » vers le style architectural pré-bouddhique et post-saint, répandu dans de nombreux vestiges ultérieurs.
Sans s'arrêter à l'architecture, le Dr Nguyen The Hung a également classé le système de statues vénérées dans les temples taoïstes en quatre groupes : les statues universelles dans les temples taoïstes ; les statues présentes dans certains temples ; les statues présentes uniquement dans certains temples individuels et un groupe de statues à caractère mixte taoïste-bouddhiste. Cette analyse illustre non seulement la diversité des croyances, mais reflète aussi clairement les caractéristiques tolérantes et flexibles de la conscience religieuse du peuple vietnamien.
L'ouvrage propose également une analyse approfondie du rôle historique et culturel du taoïsme en période de troubles. L'auteur estime qu'à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, lorsque la société vietnamienne sombrait dans une crise idéologique, le confucianisme perdit progressivement sa légitimité, et le taoïsme, avec sa philosophie de transcendance et de sérénité, devint un refuge spirituel pour les intellectuels et les mandarins.
L'ouvrage souligne également que la recherche et l'identification précise de la valeur des temples taoïstes revêtent non seulement une importance académique, mais aussi une profonde importance pratique pour la gestion, la préservation et la promotion du patrimoine culturel national. Il s'agit d'un rappel nécessaire pour les gestionnaires de la culture et des vestiges, ainsi que pour la communauté, afin de réévaluer le rôle et la place d'un patrimoine en voie d'oubli.
Source : https://hanoimoi.vn/dau-an-van-hoa-dac-sac-trong-dong-chay-tin-nguong-viet-nam-707691.html






![[Photo] Le secrétaire général To Lam assiste au 80e anniversaire de la diplomatie vietnamienne](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/25/3dc715efdbf74937b6fe8072bac5cb30)






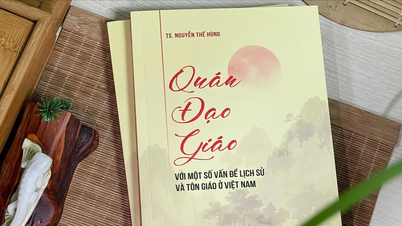







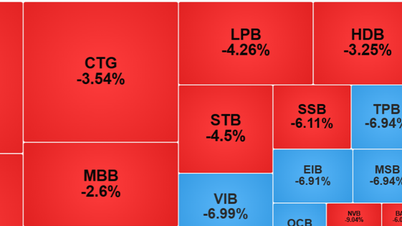
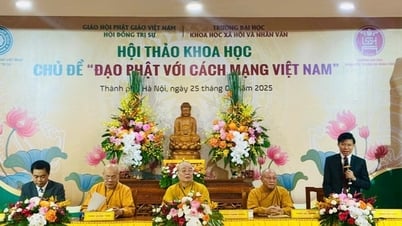










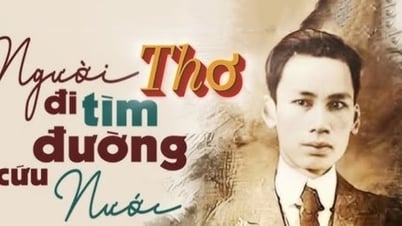














































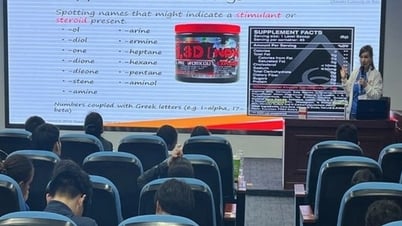





















Comment (0)