Au cours des 80 dernières années, le développement de l’éducation vietnamienne a été divisé en 5 étapes.
Période 1945-1954 : Construire une nouvelle base idéologique, éliminer l'analphabétisme, maintenir et développer le système éducatif national, former une génération de « citoyens résistants »...
Immédiatement après la Révolution d'Août, la République démocratique du Vietnam est née au milieu de nombreuses difficultés : « ennemis intérieurs et extérieurs », une économie épuisée et plus de 90 % de la population était analphabète.
Le gouvernement considérait l'éradication de l'analphabétisme et la relance de l'éducation comme des tâches urgentes. Dans les zones libérées, les mouvements d'éducation populaire et d'éducation culturelle complémentaire se sont largement répandus, les écoles ont été agrandies, les universités restaurées et l'enseignement a été dispensé en vietnamien.
Dans les zones temporairement occupées, l'éducation était un front de lutte idéologique, et le mouvement d'éducation patriotique s'y développa fortement. Les cours d'alphabétisation populaire furent maintenus clandestinement, malgré la mise en place par le gouvernement français d'un système éducatif restrictif visant à asservir, à s'opposer à la révolution, à empoisonner la jeunesse et à transformer les écoles en lieux de surveillance, de séduction et de recrutement de soldats, ainsi qu'à opprimer les enseignants et les élèves patriotes.
Période 1954-1975 : Le Nord a pratiquement éliminé l'analphabétisme et mis en place un système éducatif national complet. Le Sud a développé un système éducatif révolutionnaire, souple et durable, ainsi qu'un réseau scolaire démocratique.
Après 1954, le pays fut divisé en deux régions, le Nord et le Sud, avec deux systèmes et deux voies de développement opposés, ce qui eut un impact profond sur l'éducation. Malgré ces différences de nature, les objectifs éducatifs des deux régions connurent certains succès.
Le Nord s'est concentré sur l'éradication de l'analphabétisme avec la troisième campagne lancée à grande échelle. La réforme de l'éducation de 1956 a instauré un système d'enseignement général de dix ans, élaboré de nouveaux programmes et manuels scolaires et formé une équipe d'enseignants qualifiés.

Depuis 1958, l'éducation est devenue un élément important de la construction socialiste. Le programme d'études a été renforcé, mettant l'accent sur la pratique et le travail productif. Les universités se sont rapidement développées, passant de 5 écoles (1959-1960) à 17 (1964-1965). Durant la période 1965-1975, lorsque les États-Unis ont bombardé le Nord, le secteur éducatif s'est adapté aux conditions de guerre.
Le Sud a maintenu deux systèmes éducatifs parallèles : l’éducation sous le régime de la République du Vietnam et l’éducation dans les zones libérées. De 1954 à 1960, les classes d’éducation populaire fonctionnaient sous un « couvert légal » dans des conditions difficiles. À partir de 1961, un système éducatif révolutionnaire fut mis en place, avec son propre programme et ses propres manuels, et les écoles connurent un fort développement. De 1969 à 1975, l’éducation s’adapta avec souplesse, ouvrant des classes légales et semi-légales dans les banlieues, notamment après l’Accord de Paris.
Au cours de la période 1975-1986, le système éducatif national a été unifié, son échelle a été maintenue et élargie, l'analphabétisme a été éliminé, les connaissances de la population ont été améliorées et des politiques et directives éducatives globales ont été élaborées.
Durant les trois premières années suivant 1975, le système éducatif s'est concentré sur les tâches urgentes de l'après-guerre, telles que la prise en charge, la stabilisation et l'unification du système à l'échelle nationale. Entre 1979 et 1986, la troisième réforme globale de l'éducation a été mise en œuvre dans un contexte de crise socio-économique.
Dans ce contexte, en juin 1975, le Secrétariat a émis deux directives sur l’éducation dans le Sud, servant de ligne directrice pour la prise en charge, l’élimination de l’analphabétisme, le complément culturel, le développement des écoles et des classes et l’unification de la gestion.
Le Congrès du Parti de 1976 a également établi les fondements idéologiques du développement de l’éducation : « L’éducation est le fondement culturel d’un pays et la force future d’une nation. »
La résolution 14 du Comité central de janvier 1979 était un document juridique important qui lançait officiellement la troisième réforme de l'éducation. Cependant, dans le contexte de crise socio-économique, le Congrès du Parti de 1982 a admis sans détour que « le plus grand problème aujourd'hui est la grave dégradation de la qualité de l'éducation ».
Entre 1975 et 1978, le secteur éducatif a rapidement pris le relais et a stabilisé la quasi-totalité du système scolaire du Sud. Fin 1978, les provinces et les villes du Sud avaient pratiquement éradiqué l'analphabétisme, les écoles privées ont été dissoutes et de nombreuses universités publiques ont fusionné, créant ainsi un système de formation postuniversitaire et de doctorat associé.
Dans le contexte de la crise de 1979-1986, le système éducatif a réussi à unifier le système d'enseignement général de 12 ans à l'échelle nationale. Pour la première fois, un programme et des manuels scolaires uniques ont été élaborés et appliqués. Cependant, la crise socio-économique a eu un impact direct et grave sur l'éducation. Les infrastructures se sont dégradées, le budget de l'éducation ne représentait que 3,5 à 3,7 % des dépenses totales, principalement consacrées aux salaires. À une époque, 40 % des salles de classe du pays étaient des salles de classe temporaires en bambou et en chaume. La vie des enseignants était difficile, la qualité de l'enseignement a décliné et les effectifs scolaires ont fluctué.
Au cours de la période 1986-2000, l’éducation a été la principale politique nationale, le cadre juridique et les institutions ont été progressivement améliorés, socialisés et diversifiés.
Le 6e Congrès du Parti (décembre 1986) a souligné les faiblesses et exigé une innovation dans la pensée, considérant l'éducation comme une partie inséparable de la cause générale de l'innovation.
La résolution centrale 6 (1989) préconisait la diversification de la formation, l’expansion des écoles non publiques et le déplacement du mécanisme financier de la subvention vers la mobilisation de nombreuses sources avec les frais de scolarité.

Au 7e Congrès national du Parti (1991), l'éducation et la formation étaient considérées comme la « politique nationale suprême » avec pour mission « d'améliorer les connaissances des gens, de former les ressources humaines, de nourrir les talents », investir dans l'éducation, c'est investir dans le développement...
La politique du Parti a été institutionnalisée par des lois, telles que la loi sur l’éducation primaire universelle (1991), et en particulier la loi sur l’éducation (1998).
Au cours de la période 2000-2025, la politique éducative est systématiquement la première politique nationale, le budget de l'éducation représente 20 % des dépenses totales, la transformation numérique et l'intégration internationale.
La résolution n° 29 du Comité central de 2013 a affirmé l’importance de l’éducation, en donnant la priorité aux dépenses du budget de l’État consacrées à l’éducation, atteignant au moins 20 % des dépenses totales.
Au cours des dix premières années du XXIe siècle, l'éducation s'est concentrée sur le renforcement des bases et l'universalisation. En 2000, le Vietnam avait achevé l'éducation primaire universelle et éradiqué l'analphabétisme. En juin 2010, 63 provinces et villes atteignaient les normes d'enseignement secondaire universel du premier cycle. De nouveaux programmes et manuels d'enseignement général ont été mis en œuvre depuis 2002.
La loi sur l'éducation de 2005 a aboli le modèle semi-public et l'a remplacé par des modèles privés et non publics, créant ainsi un cadre juridique pour la socialisation de l'éducation. La loi sur la formation professionnelle de 2006 a mis l'accent sur l'enseignement professionnel. Cette loi a introduit pour la première fois le concept d'« évaluation de la qualité ».
Durant cette période, l'éducation et la formation sont également entrées dans une phase d'innovation fondamentale et globale. Le 11e Congrès du Parti (2011) a désigné l'éducation et la formation comme la principale politique nationale, la Stratégie de développement de l'éducation 2011-2020 (Décision 711, 2012), la Loi sur l'enseignement supérieur de 2012 et surtout la Résolution 29-NQ/TW (2013) ont créé un cadre juridique propice à l'innovation globale.
La pandémie de Covid-19 (2020-2021) a favorisé l'enseignement en ligne avec pour devise « cesser temporairement d'aller à l'école, pas cesser d'apprendre ». Depuis la pandémie, la transformation numérique est devenue l'orientation stratégique du secteur.
Source : https://vietnamnet.vn/80-nam-giao-duc-viet-nam-tu-90-dan-so-ca-nuoc-mu-chu-den-hoi-nhap-quoc-te-2437322.html



![[Photo] Ho Chi Minh-Ville est remplie de drapeaux et de fleurs à la veille de la fête nationale le 2 septembre](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/f493a66401844d4c90919b65741ec639)
![[Photo] Le président Luong Cuong reçoit le président de la Chambre des représentants (Chambre basse) de la République de Biélorussie, Igor Sergeyenko](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/a67d61e41405410999a43db45a0ba29c)
![[Photo] Le président de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhao Leji, visite le mausolée de Ho Chi Minh](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/45b2a2744fa84d27a59515b2fe53b42a)

![[Photo] Le secrétaire général To Lam préside la cérémonie d'accueil du premier secrétaire et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/4f6ef5136b90463db3ebdd3d3d83ebe4)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam s'entretient avec le premier secrétaire et président de la République de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/1/a2eab2ee4e4a4a81a8c605e46055ab78)


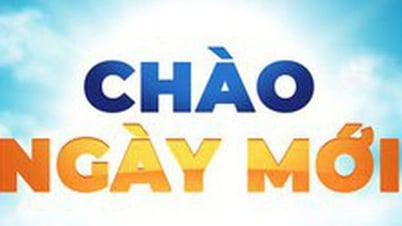



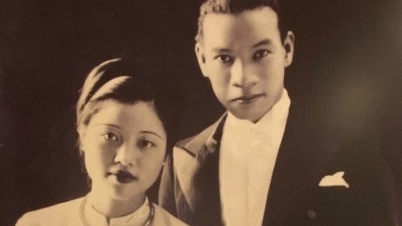













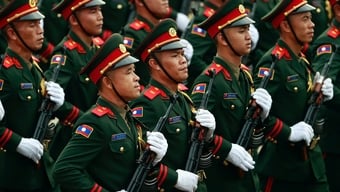



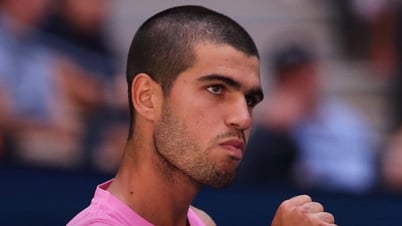
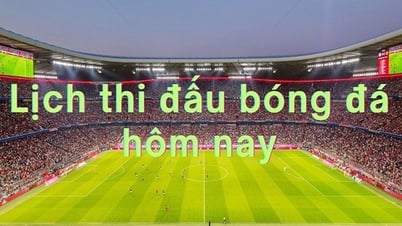
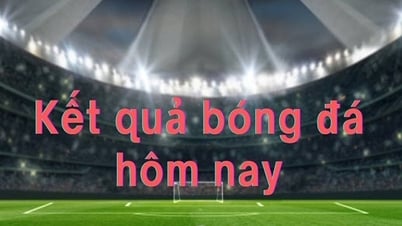


























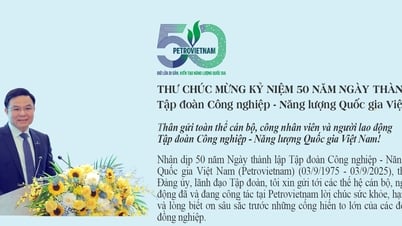











































Comment (0)