
Enseignement supérieur pour le développement durable
De nombreux chercheurs estiment que le développement durable de l'enseignement supérieur est indissociable de la réflexion sur l'enseignement supérieur. Dans le monde , l'enseignement supérieur fonctionne selon un modèle qui répondait simplement aux besoins sociaux et a évolué vers un modèle privilégiant les valeurs humaines. Cette adaptation s'oriente vers un leadership au service de la communauté, de l'innovation et des écosystèmes universitaires. Dans ce contexte, un leadership axé sur le service aux personnes, l'écoute, l'autonomisation et le développement des individus est considéré comme le point de départ du processus de transformation organisationnelle. Sur cette base, l'innovation est promue dans une perspective éthique, globale et axée sur les valeurs. Le modèle d'écosystème universitaire proposé par Ronald Barnett (1) peut servir de voie à l'enseignement supérieur pour établir un lien entre le savoir, la société et le monde naturel. Les recherches sur l'approche du leadership au service de la communauté, de l'innovation et des écosystèmes universitaires offrent une perspective sur la philosophie de l'enseignement supérieur pour le développement durable.
Du leadership administratif au leadership du service communautaire dans l’éducation
Le concept de leadership serviteur a été évoqué pour la première fois par l'auteur Robert K. Greenleaf (2) dans son ouvrage « The Servant is the Leader » (3) dans les années 1970. Il s'agissait d'une perspective critique et proposait de nouveaux ajustements au modèle traditionnel de leadership en éducation, qui privilégie le pouvoir, le contrôle et les résultats plutôt que le développement humain. Un véritable leader doit être un « serviteur d'abord », c'est-à-dire privilégier l'écoute, l'empathie, l'attention et le développement des autres avant d'exercer son leadership. Le leadership serviteur met l'accent sur le rôle du leader au service de la communauté et de l'équipe qu'il dirige. Dans l'éducation, le leadership serviteur vise à soutenir, responsabiliser et répondre aux besoins de développement des enseignants et des apprenants, tout en créant un environnement éducatif positif et durable.
Le leadership au service de la communauté apporte de nombreux avantages pratiques au système éducatif, tels que :
Premièrement, le leadership-serviteur favorise et soutient l'épanouissement personnel des apprenants et des enseignants. En écoutant, en comprenant et en se souciant véritablement des besoins des enseignants et des étudiants, il permet à chacun d'atteindre son plein potentiel, tout en renforçant son intelligence émotionnelle et son engagement au sein de la communauté universitaire. Ce modèle a notamment un impact direct sur la satisfaction professionnelle et la qualité du travail des enseignants.
Deuxièmement, un leadership communautaire crée un environnement de travail positif et durable, créant une culture organisationnelle fondée sur la confiance, la flexibilité, la collaboration et l'appropriation. Sous la direction de leaders communautaires efficaces, les enseignants affichent souvent un niveau de satisfaction professionnelle plus élevé, contribuant ainsi à l'efficacité organisationnelle et à la stabilité du personnel des établissements d'enseignement.
Troisièmement, le leadership-serviteur favorise l'engagement, ce qui contribue à la réussite des élèves. En créant un environnement d'apprentissage sûr, encourageant et collaboratif, il accroît l'engagement, la responsabilisation et la motivation intrinsèque des élèves. Ce modèle s'est également avéré efficace pour apporter un soutien psychologique et un soutien en matière de santé mentale aux élèves.
Quatrièmement, le leadership de service favorise le développement professionnel et améliore l'efficacité de l'enseignement et de la recherche des enseignants. Le développement professionnel, l'amélioration de l'auto-efficacité et le renforcement de la collaboration sont des résultats importants du leadership de service.
Actuellement, la mise en œuvre du modèle de leadership communautaire dans l'éducation se heurte encore à de nombreux défis dans certains pays. L'un des principaux obstacles réside dans les facteurs culturels et institutionnels, car de nombreux établissements d'enseignement fonctionnent encore de manière traditionnelle, privilégiant la centralisation du pouvoir et du contrôle, ce qui complique l'adaptation au modèle de leadership communautaire. Pour surmonter cet obstacle, les établissements d'enseignement doivent élaborer et mettre en œuvre des stratégies appropriées, tout en adaptant leur modèle de leadership de manière globale et flexible au contexte, au niveau scolaire et aux caractéristiques organisationnelles.
L'innovation dans l'éducation en repensant les modèles, les structures et les relations dans le système éducatif
Aujourd'hui, l'innovation n'est plus simplement comprise comme l'application de nouvelles technologies ou méthodes, mais comme un processus continu de création de nouvelles valeurs en repensant les modèles, les structures et les relations dans le système éducatif (4) . L'innovation dans l'enseignement supérieur comprend : i- L'innovation pédagogique - apprentissage actif, apprentissage expérientiel, intégration interdisciplinaire ; ii- L'innovation de gestion - gestion intelligente selon la mission, autonomie, flexibilité, transparence des données ; iii- L'innovation sociale - universités liées à la communauté, résolution de problèmes sociaux ; iv- L'innovation des start-up - promotion de l'entrepreneuriat, développement d'idées commerciales à partir des résultats de la recherche, soutien à la commercialisation des connaissances, connexion avec les entreprises et construction d'un écosystème d'innovation dans les écoles.
L’innovation éducative par la remise en question du modèle, de la structure et des relations au sein du système éducatif est une approche dans laquelle le leadership au service de la communauté agit comme un catalyseur, facilitant un environnement propice à l’innovation : en favorisant la confiance, en soutenant l’expérimentation de nouvelles idées, en prêtant attention aux aspects éthiques de l’innovation et en orientant l’innovation des intérêts personnels et organisationnels vers la promotion des intérêts de la communauté.
Intégrer l'écosystème universitaire à l'écosystème social
Le modèle d'écosystème universitaire développé par Ronald Barnett (5) ouvre une nouvelle approche de l'enseignement supérieur au XXIe siècle. Ne se limitant plus à un rôle de découverte du savoir ou de formation professionnelle, l'écosystème universitaire se place au cœur des relations complexes entre les individus, le savoir et l'écosystème dans son ensemble. Il s'agit non seulement d'élargir le champ d'action de l'établissement, mais aussi de restructurer sa philosophie de fonctionnement, afin de garantir que les établissements d'enseignement supérieur assument pleinement leurs responsabilités sociales et soient attentifs aux aspects éthiques de l'écosystème dans son ensemble.
Le modèle d'écosystème universitaire repose sur une pensée systémique et une approche multidimensionnelle, où les différents écosystèmes sont constamment interconnectés et s'influencent mutuellement. Ronald Barnett a identifié huit écosystèmes principaux que les écosystèmes universitaires doivent identifier et auxquels ils doivent participer, notamment le savoir, l'éducation, les personnes, l'organisation sociale, la culture, l'économie, la politique et la nature. Les établissements d'enseignement non seulement subissent l'influence de ces écosystèmes, mais ont également la responsabilité de les restaurer, de les protéger et de les développer de manière proactive, à travers trois missions fondamentales : l'éducation, la recherche et le service à la communauté.
Contrairement au modèle universitaire qui se concentre sur les normes de résultats des programmes de formation ou les résultats de la recherche, l'écosystème universitaire repose sur une éthique responsable, privilégiant l'intégrité, l'honnêteté et le dialogue critique dans les activités académiques et administratives. Parallèlement, il encourage les établissements à cultiver l'empathie et la responsabilité à long terme envers les générations futures et l'ensemble de la biosphère, en considérant l'éducation comme un processus de co-création de la vie en interaction avec la nature et la société (6) .
L'écosystème universitaire accorde également une grande importance à l'engagement communautaire et culturel, encourageant les étudiants et les professeurs à s'engager activement dans la résolution des problèmes sociaux, culturels et environnementaux locaux. Cela transforme la culture universitaire en une culture d'action non seulement « dans le monde », mais aussi « pour le monde ».
Des études récentes montrent la diversité des modes de mise en œuvre du modèle d'écosystème universitaire dans différents pays. En Turquie, un modèle de connexion organique entre les universités et l'environnement naturel, culturel et économique local a été mis en place dans certains endroits. En Chine, certains établissements d'enseignement supérieur non publics ont choisi la philosophie écologique comme fondement de leurs stratégies globales de développement et d'innovation. Dans les pays d'Amérique du Sud, les étudiants en langues peuvent utiliser l'art multimédia pour recréer le concept d'écosystème universitaire, tout en mettant l'accent sur les valeurs humaines, les droits de l'homme et la responsabilité sociale.
L'écosystème universitaire se caractérise par les trois piliers suivants : i- La pensée systémique, qui reconnaît l'université comme un élément organiquement lié aux systèmes socio-environnementaux plus vastes ; ii- La responsabilité multidimensionnelle, qui s'exerce non seulement envers les étudiants, mais aussi envers la communauté, la nature et les générations futures ; iii- La symbiose, qui fait de l'université un environnement bienveillant, favorisant l'apprentissage, la créativité et la symbiose entre les individus, entre les individus et le monde naturel. Plus important encore, la formation et le fonctionnement de l'écosystème universitaire ne peuvent se résumer à de simples réglementations administratives, mais nécessitent un processus d'ajustement endogène de la philosophie du leadership, de la culture organisationnelle et du système de valeurs académiques. En particulier, le modèle de leadership au service de la communauté peut jouer le rôle de catalyseur initial, tandis que l'innovation devient un outil clé pour concrétiser la philosophie de l'enseignement universitaire.
Enjeux du processus d'ajustement du leadership : du leadership au service de la communauté à l'innovation et aux écosystèmes universitaires
Il s'agit d'un parcours où l'enseignement supérieur passe d'une « gestion axée sur la performance » à une « éducation pour la vie ». Le modèle en trois phases ci-dessous représente une approche systémique, reliant les individus, les connaissances et l'écosystème socio-environnemental.
Phase 1 : Leadership serviteur
Dans toute transformation fondamentale d'un établissement d'enseignement, l'humain est toujours au cœur de ses préoccupations. Le modèle de leadership au service de la communauté pose ce principe fondamental : les dirigeants placent l'humain au cœur du processus d'apprentissage et de développement, au cœur de toutes les activités. Ce principe est particulièrement important dans l'enseignement supérieur, où certains établissements se concentrent uniquement sur les exigences administratives ou sur une simple évaluation et un classement, ce qui peut facilement les éloigner des besoins réels des apprenants et de la communauté. Un leadership au service de la communauté contribue à établir la confiance interne, à créer un espace psychologiquement sécurisant et à encourager la participation de la base aux activités d'innovation. C'est l'étape de construction d'une philosophie organisationnelle où les apprenants sont respectés, les enseignants écoutés et l'esprit de service devient la philosophie de leadership.
Phase 2 : Innovation
Une fois les fondements humanistes posés, l'organisation peut passer à l'étape suivante : promouvoir l'innovation globale. L'innovation ne se limite pas à améliorer l'application des acquis scientifiques et technologiques ou les méthodes d'enseignement, mais vise également à repositionner les objectifs d'apprentissage, à développer les espaces d'apprentissage interdisciplinaires et transversaux, et à repenser la relation entre enseignants, étudiants, communauté et établissement.
Le modèle innovant inspiré du leadership communautaire est souvent plus autonome, flexible et éthique. Il permet aux individus d'oser expérimenter et d'agir pour des valeurs communes, telles que la justice sociale, la durabilité environnementale et le développement communautaire. C'est à ce stade que les écoles amorcent leur transformation vers l'innovation, en diversifiant leurs initiatives éducatives, tout en conservant une orientation claire vers les valeurs.
Phase 3 : Écosystème universitaire
Une fois qu'une université a développé un écosystème d'innovation responsable, l'étape suivante consiste à devenir un écosystème universitaire. À ce stade, l'université fonctionne non seulement comme un établissement de formation ou de recherche, mais aussi comme partie intégrante d'un écosystème socio-naturel plus vaste.
L'écosystème universitaire se préoccupe de la qualité de vie plutôt que de la simple performance académique ; il participe à la résolution des grands problèmes actuels, tels que les inégalités sociales, le changement climatique… À l'heure actuelle, il joue un rôle d'entité responsable non seulement envers les apprenants, mais aussi envers la société et la planète. C'est l'objectif du voyage visant à adapter la philosophie de l'enseignement supérieur, où l'éducation ne se limite pas à la façon de vivre, mais fait aussi partie intégrante de l'activité vitale.
Au cours de ces trois étapes, chacune reflète un ajustement progressif de l'orientation managériale vers des valeurs humanistes, l'innovation responsable et l'intégration écologique. Dans la phase initiale, la philosophie centrale est « au service des personnes », ce qui signifie que le leader se concentre sur les besoins, le développement et le bonheur des membres de l'organisation. Le principal processus d'ajustement consiste à bâtir une culture organisationnelle fondée sur la confiance, le consensus et la coopération, dans le but de créer une confiance mutuelle et une co-création entre les individus, favorisant ainsi l'esprit collectif.
Alors que le système d'enseignement supérieur entre dans une période de réformes plus vigoureuses, la philosophie centrale est « l'innovation responsable », c'est-à-dire la promotion de l'innovation parallèlement à la responsabilité sociale et à l'éthique professionnelle. L'ajustement se concentre désormais sur la restructuration de l'organisation afin de créer un espace d'expérimentation, en s'adaptant à la complexité et à l'évolution rapide du contexte de l'enseignement supérieur à l'ère de l'économie du savoir.
L'étape suivante consiste à transformer l'université en une entité écologique, fonctionnant selon la philosophie de l'« écologie éthique », conciliant développement des connaissances et développement durable. La vision et la mission de l'organisation sont repensées pour mieux s'intégrer aux enjeux mondiaux. L'objectif est désormais non seulement l'efficacité interne, mais aussi une connexion durable avec la communauté, l'environnement et le monde.
En général, le développement de l'enseignement supérieur passe du modèle centripète (au service des apprenants et des enseignants) au modèle adaptatif (innovation et responsabilité sociale), puis au modèle écologique durable (intégration profonde à la communauté et au monde). C'est cette voie de développement qui permet aux établissements d'enseignement supérieur non seulement d'améliorer la qualité de la formation et de la recherche, mais aussi de contribuer au développement durable de la société.

Quelques questions à soulever à l'avenir
Le modèle en trois phases, du leadership au service de la communauté à l'innovation et à l'écosystème universitaire, est non seulement un modèle associé au développement organisationnel, mais aussi la formation d'une nouvelle philosophie de l'enseignement supérieur axé sur la communauté, pour un développement durable de l'enseignement supérieur. Dans un contexte où les établissements d'enseignement supérieur sont soumis à une pression croissante due à la mondialisation, à la marchandisation et à la numérisation, il est urgent de repenser les fondements philosophiques afin de garantir que l'éducation promeuve l'humanisme et une mission libérale. En commençant par le leadership au service de la communauté, ce modèle contribue à promouvoir les valeurs humanistes de l'enseignement supérieur et à promouvoir l'innovation au sein de l'organisation, progressant ainsi vers une vision globale, humaine et durable, faisant de l'école un maillon de l'écosystème mondial.
Le processus d'autonomie des universités ouvre un nouvel espace aux établissements d'enseignement supérieur pour restructurer leurs modèles organisationnels. Cependant, au-delà des acquis initiaux, l'autonomie universitaire reste centrée sur la gestion administrative et financière pure, tandis que la philosophie du développement durable et l'innovation communautaire sont peu présentes. Ce modèle proposé d'adaptation de la philosophie de l'enseignement supérieur peut servir de cadre directeur pour un processus d'autonomie universitaire approfondi, et pas seulement pour une autonomie financière ou en ressources humaines. Afin d'adapter progressivement la philosophie de l'enseignement supérieur à un leadership au service de la communauté, certains pays s'orientent vers un modèle de soutien, d'accompagnement et de développement de l'autonomie des apprenants et des établissements d'enseignement. De nombreux établissements d'enseignement supérieur construisent leur identité et leur modèle de développement durable. Selon cette approche, la réflexion des générations de dirigeants du secteur de l'éducation est de plus en plus orientée vers la communauté, vers les valeurs de service, de partage et de connexion.
Cependant, l'adaptation de la philosophie de l'enseignement supérieur se heurte également à des difficultés : de nombreux établissements d'enseignement n'ont pas véritablement œuvré en faveur de l'innovation ; le cadre politique de promotion est flou ; les aspects éthiques, le service communautaire ou la responsabilité écologique n'ont pas été pleinement évalués et apparaissent fréquemment dans les critères d'accréditation et de classement. Les capacités de leadership, qui reflètent la philosophie de l'enseignement supérieur, sont encore insuffisantes ; la plupart des responsables pédagogiques sont formés à la gestion administrative et ne sont pas dotés d'une pensée de leadership au service de la communauté.
L'enseignement supérieur du XXIe siècle est confronté à des défis complexes et multidimensionnels. Dans ce contexte, il est essentiel d'adapter la philosophie de l'enseignement supérieur à l'innovation et à l'orientation communautaire.
Ce modèle est important dans le contexte de la promotion de l'autonomie universitaire au niveau national, car il ouvre une nouvelle perspective sur la philosophie de l'enseignement supérieur – autonomie en termes de vision, de valeurs, d'organisation et de mission sociale –, en plus des facteurs de gouvernance tels que les finances, les ressources humaines ou les programmes de formation. Cependant, pour concrétiser ce modèle, l'enseignement supérieur ne peut s'appuyer uniquement sur le rôle de la direction et de l'équipe de gestion ; il nécessite une évolution synchrone de la culture organisationnelle, des mécanismes, des politiques et des capacités de mise en œuvre à de nombreux niveaux.
Pour mettre en œuvre efficacement le processus d’adaptation de la philosophie de l’enseignement supérieur au développement durable, les solutions suivantes devraient être envisagées :
Premièrement, développer les capacités de leadership pour servir et transformer : il est nécessaire de concevoir des programmes de formation et de perfectionnement pour les dirigeants et les gestionnaires de l’enseignement supérieur axés sur le service et la transformation, avec une vision écologique. Encourager la recherche sur l’application de modèles de leadership humains, créatifs et durables, adaptés aux conditions nationales.
Deuxièmement, créer un environnement propice à l'innovation responsable : pour concrétiser ce modèle, il est nécessaire de former l'équipe de direction et les responsables pédagogiques à une réflexion axée sur les services et l'écosystème, de mettre en place un mécanisme de test, d'évaluation et d'amélioration contrôlé pour formuler des idées innovantes et d'intégrer les valeurs écologiques et sociales dans le cadre d'évaluation de la qualité de l'éducation. Créer un espace de test contrôlé (bac à sable) dans les établissements d'enseignement supérieur pour permettre la mise en œuvre d'initiatives interdisciplinaires en matière d'éducation, d'enseignement et de recherche au bénéfice de la communauté et de l'environnement. Appliquer un mécanisme de rétroaction, d'évaluation et d'amélioration continue pour favoriser une culture d'innovation responsable.
Troisièmement, intégrer la pensée écologique dans la stratégie de développement universitaire : concevoir la stratégie de développement scolaire, le programme et la recherche basés sur la pensée écologique, y compris l’écologie académique (connaissance), l’écologie sociale (communauté) et l’écologie environnementale (durabilité).
Quatrièmement, réformer les politiques et les systèmes d'évaluation : intégrer les critères sociaux, environnementaux et écologiques académiques dans le système d'accréditation, de classement et d'évaluation de la qualité des universités. Les recherches sur l'élaboration d'un cadre politique pour l'autonomie des universités sont approfondies et ne se limitent pas à la gestion administrative et financière.
Cinquièmement, encourager la coopération écosystémique : promouvoir les relations de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur et les localités, les entreprises, les organisations sociales, les organisations environnementales et les instituts de recherche pour former un réseau d’action écologique.
-------------------
(1) Analyste de l'enseignement supérieur, professeur émérite d'enseignement supérieur à l'Institute of Education, University College London
(2) (1904 - 1990), chercheur en gestion, développement et éducation, fondateur du mouvement moderne de leadership serviteur et du Greenleaf Center for Servant Leadership aux États-Unis
(3) Voir : Robert K. Greenleaf : Qu'est-ce que le leadership serviteur ?, https://greenleaf.org/what-is-servant-leadership/
(4) Voir : Nguyen Huu Duc, Nguyen Huu Thanh Chung, Nghiem Xuan Huy, Mai Thi Quynh Lan, Tran Thi Bich Lieu, Ha Quang Thuy, Nguyen Loc : « Approche de l'enseignement supérieur 4.0 - Caractéristiques et critères d'évaluation », Journal of Science : Policy and Management Research, Université nationale de Hanoi , vol. 34, n° 4 (2018), pp. 1 - 28
(5) Voir : Ronald Barnett : L'université écologique - Une utopie réalisable , Routledge, Londres et New York. 2018, https://doi.org/10.4324/9781315194899
(6) Voir : Nguyen Huu Thanh Chung, Tran Van Hai, Luu Quoc Dat, Nancy W Gleason, Nguyen Huu Duc : « Mesurer la réactivité de la 4RI dans l'enseignement supérieur vietnamien », Journal of Institutional Research South East Asia, 20 (2), septembre/octobre 2022 ; http://www.seairweb.info/journal/articles/JIRSEA_v20_n02/JIRSEA_v20_n02_Article01.pdf
Source : https://tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/1125003/giao-duc-dai-hoc-vi-su-phat-trien-ben-vung---nhung-van-de-dat-ra.aspx



![[Photo] Les habitants de Ho Chi Minh-Ville montrent leur affection pour célébrer le 80e anniversaire de la Révolution d'août et la Fête nationale le 2 septembre](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/3/55d860cbb63a40808e1e74ad9289b132)
![[Photo] Le président laotien Thongloun Sisoulith et le président du Parti du peuple cambodgien et président du Sénat cambodgien Hun Sen visitent l'exposition du 95e anniversaire du drapeau du parti éclairant le chemin](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/3c1a640aa3c3495db1654d937d1471c8)


![[Photo] Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre le premier secrétaire et président de Cuba, Miguel Diaz-Canel Bermudez](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/c6a0120a426e415b897096f1112fac5a)
![[Photo] Programme artistique spécial « Da Nang - Connecter le futur »](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/efdd7e7142fd45fabc2b751d238f2f08)

















![[Vidéo] Petr Tsvetov : Le Vietnam est chaleureux et familier](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/402x226/vietnam/resource/IMAGE/2025/9/2/5f0c1739d6c34747b2da4c57cc5dc013)







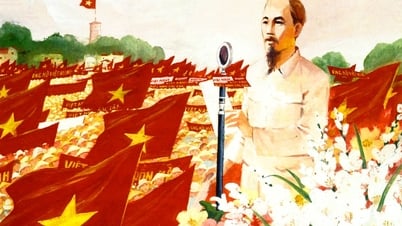



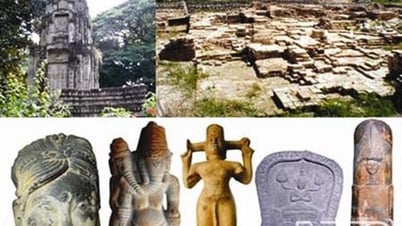





























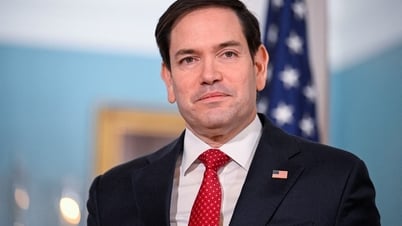

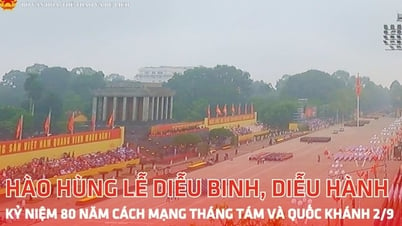














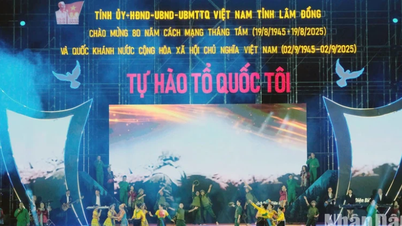

















Comment (0)