Ce phénomène a donné lieu à des débats acharnés entre le besoin d’espace personnel et les pressions professionnelles.
La culture cagongjok a explosé au début des années 2010 en Corée du Sud avec l'essor rapide des chaînes de café franchisées. Ce concept désigne l'acte de « s'installer » dans les bars pour profiter de l'électricité et du Wi-Fi gratuits au prix d'un simple verre d'eau.
Les étudiants constituent le public cible privilégié de la culture cagongjok. Ce groupe dispose de budgets limités et manque d'espaces confortables et pratiques pour étudier. C'est pourquoi ils s'installent souvent en groupe ou individuellement dans les cafés après les cours. Pendant la période des examens, ils s'y installent presque comme des « racines ».
À Daechi, Séoul, Hyun Sung-joo, propriétaire d'un petit café, est confronté à un dilemme. Certains clients apportent deux ordinateurs portables et une prise de courant à six ports, se créant ainsi un « mini-bureau » et y restant assis toute la journée. Compte tenu des loyers élevés, Hyun explique qu'il serait difficile de pérenniser son activité si cette situation devenait courante.
Les petits commerces ne sont pas les seuls concernés : même Starbucks Corée, la plus grande chaîne de cafés du pays, est confrontée à une situation similaire. L'entreprise a récemment publié des directives pour limiter les « cas extrêmes », comme les clients apportant des écrans de bureau, des imprimantes ou laissant les bureaux vides pendant des heures.
Cette politique a suscité des réactions mitigées. Certains clients l'ont accueillie favorablement, la considérant comme une étape nécessaire pour que les cafés retrouvent leur véritable fonction de lieux de détente et de discussion.
On dit que l'encombrement excessif complique la tâche des retardataires et que l'atmosphère calme gêne les personnes souhaitant socialiser. À l'inverse, certains critiquent Starbucks pour avoir abandonné la tradition du « non-intervention » qui le rendait autrefois si attrayant.
Si les grandes chaînes peuvent fixer des règles nationales, les petits cafés sont livrés à eux-mêmes. Certains acceptent les Cagongjok comme clients réguliers, à condition qu'ils respectent l'espace public et commandent des boissons supplémentaires. D'autres, au contraire, imposent des mesures strictes comme la limitation du temps d'attente, la mise en place de « zones sans étude » ou même la coupure des prises électriques.
« Deux clients pouvaient rester assis pendant 10 heures, occupant ainsi la place de 10 autres personnes », explique Kim, propriétaire du café de Jeonju. « Nous avons finalement dû limiter les heures d'étude à deux heures maximum. Ceci afin d'éviter les conflits entre clients. »
D'autre part, Cagongjok reflète également la forte concurrence qui règne dans la société coréenne. Les étudiants doivent se préparer à l'examen d'entrée à l'université de Suneung, tandis que les jeunes sont confrontés à un marché du travail instable et à des conditions de logement exiguës. Le professeur Choi Ra-young, de l'université d'Ansan, estime que ce phénomène découle du manque d'espaces publics adaptés aux études et au travail.
Alors que près de 70 % de la génération Z en Corée du Sud déclare étudier dans un café au moins une fois par semaine, le Cagongjok a peu de chances de disparaître complètement. Selon les experts, la solution n'est pas de bannir le Cagongjok, mais de créer des espaces multifonctionnels où étudier et discuter peuvent cohabiter.
« Nous avons besoin de lignes directrices et d'environnements inclusifs, plutôt que de simplement éliminer ce phénomène. S'ils sont bien organisés, les cafés peuvent devenir de véritables espaces communautaires pour la société moderne », a déclaré le professeur Choi Ra-young, de l'Université d'Ansan, en Corée du Sud.
Source : https://giaoducthoidai.vn/han-quoc-quan-ca-phe-tro-thanh-phong-hoc-post745787.html




![[Photo] Le secrétaire général To Lam remet l'insigne des 45 ans d'adhésion au Parti au camarade Phan Dinh Trac](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/e2f08c400e504e38ac694bc6142ac331)
![[Photo] Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président du Parlement néo-zélandais Gerry Brownlee](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/cec2630220ec49efbb04030e664995db)
![[Photo] Un drapeau rouge avec une étoile jaune flotte en France le jour de la fête nationale le 2 septembre](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/f6fc12215220488bb859230b86b9cc12)
![[Photo] Le Politburo travaille avec le Comité permanent du Comité du Parti provincial de Cao Bang et le Comité du Parti de la ville de Hué](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/fee8a847b1ff45188749eb0299c512b2)
![[Photo] Le secrétaire général To Lam assiste à la cérémonie d'ouverture de l'Exposition nationale des réalisations](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/8/28/d371751d37634474bb3d91c6f701be7f)









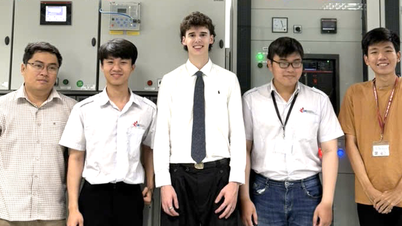




















































































Comment (0)