Le 23 août 1973, le fugitif suédois Jan-Erik Olsson entra dans la Sveriges Kreditbank, place Norrmalmstorg à Stockholm, peu après son ouverture. Il était déguisé avec une perruque bouclée de femme, des lunettes de soleil bleues, une moustache noire et des joues roses. Olsson tira un coup de mitraillette vers le plafond et cria en anglais : « Que la fête commence ! »
Les choses sont devenues bizarres à partir de là.
Lorsqu'Olsson est entré dans la banque, les employés devenus ses otages n'ont ressenti que de la peur. « J'ai cru qu'un fou était entré dans ma vie », a déclaré Kristin Enmark, une employée de banque de 23 ans à l'époque.
Mais la terreur des otages ne dura pas longtemps. En effet, au cours des six jours du braquage, un lien surprenant se forma entre le braqueur et les quatre otages, trois femmes et un homme. Ce lien donna naissance à un nouveau terme psychologique : le syndrome de Stockholm.
Olsson purgeait une peine de trois ans pour cambriolage. Début août 1973, la prison l'autorisa à être libéré quelques jours pour bonne conduite, à condition qu'il se présente à la fin de sa peine. Olsson ne revint pas, préparant un cambriolage audacieux.
Au lieu de braquer la banque, Olsson prit les jeunes employés en otage et formula des exigences à la police. Il réclamait 3 millions de couronnes suédoises (environ 710 000 dollars à l'époque) et une voiture pour fuir. De plus, pour appuyer son plan, Olsson exigeait que la police lui livre son ancien compagnon de cellule, Clark Olofsson, célèbre dans toute la Suède pour ses braquages de banques et ses multiples évasions.
Olsson a fait le pari que « le gouvernement ne prendrait pas le risque de refuser la demande et de risquer le meurtre de femmes », écrit l'auteur David King dans son livre 6 Days in August: The Story of Stockholm Syndrome. « Pas en Suède. Certainement pas cette année-là, alors que le Premier ministre était confronté à des élections serrées. »
Alors que des tireurs d'élite encerclaient le bâtiment, Olsson s'est retiré dans le coffre de la banque avec les otages, laissant la porte entrouverte et attendant que ses demandes soient satisfaites.
Enmark a été menotté avec deux collègues, la caissière Elisabeth Oldgren, 21 ans, et Birgitta Lundblad, 31 ans, la seule otage mariée et mère de enfants.
Au départ, les calculs d'Olsson étaient corrects. Les autorités transférèrent l'argent, une Ford Mustang bleue et Clark Olofsson à la Kreditbank plus tard dans la journée. Olsson prévoyait de partir avec l'argent, Clark et plusieurs otages, puis de fuir la Suède par bateau.
Mais la police avait conservé les clés de la Mustang. Olsson et son groupe étaient piégés.
Furieux, Olsson hurla et menaça de tuer ceux qui intervenaient, tirant même dans le bras d'un policier. Mais l'apparition de Clark calma l'attention de la banque.
« Quand je suis arrivé, ils étaient terrifiés », a déclaré Clark en 2019. « Au bout de cinq minutes, ils se sont calmés. Je leur ai dit : “Calmez-vous, on va s'en occuper.” » Clark a détaché les trois femmes et a fait le tour de la banque pour évaluer la situation. Il a trouvé un autre employé, Sven Safstrom, 24 ans, caché dans la réserve. Safstrom est devenu le quatrième otage.
Clark apporta un téléphone bancaire dans le coffre pour que les otages puissent appeler leurs familles. Alors que Lundblad pleurait, incapable de joindre son mari et ses enfants, Olsson lui toucha la joue et lui dit doucement : « Réessaye, n'abandonne pas. »
Jour deux
Le 24 août 1973, après sa première nuit dans le coffre, Oldgren se sentit claustrophobe. Olsson coupa donc une corde, la lui noua autour du cou et la fit faire le tour de la banque. Il lui entoura également les épaules de son manteau, tandis qu'elle grelottait de froid.
Olsson était de plus en plus frustré par la lenteur des autorités. Il convainquit Safstrom de le laisser lui tirer une balle dans la cuisse, sous les yeux de la police, en guise de menace. Olsson promit que le tir ne ferait qu'effleurer. « Juste la jambe », dit Enmark à Safstrom en guise d'encouragement.
Safstrom a accepté, mais Olsson n'a finalement rien fait. « Je ne sais toujours pas pourquoi le plan n'a pas fonctionné. Je me souviens seulement de sa gentillesse lorsqu'il a promis de me tirer une balle dans la jambe », a déclaré Safstrom.
Pendant ce temps, la foule s'est rassemblée sur la place Norrmalmstorg, devant la banque, et les médias ont continué à rendre compte des événements, interviewant les otages et leurs ravisseurs par téléphone.
Vers 17 heures, Enmark s'est entretenue avec le Premier ministre suédois Olof Palme, et les stations de radio et de télévision ont également diffusé leur conversation. Elle a demandé au Premier ministre Palme de permettre à Olsson de quitter la banque et de repartir avec l'argent. Enmark s'est porté volontaire pour l'accompagner comme otage.
« J'avais une confiance totale en Clark et le braqueur de banque. Je n'étais pas désespéré. Ils ne nous avaient rien fait », a déclaré Enmark. « Au contraire, ils étaient très gentils. Ce que je craignais, c'était que la police attaque et nous tue. »
Les dirigeants suédois ont refusé, affirmant que laisser des braqueurs de banque dans les rues avec des armes mettrait en danger la population.
Le déguisement d'Olsson a fonctionné. La police l'a identifié par erreur comme un autre évadé que Clark connaissait, Kaj Hansson. Ils ont même fait intervenir le frère cadet de Hansson, Dan, pour tenter de calmer le braqueur, mais n'ont reçu que des coups de feu en retour. La police a demandé à Dan d'appeler le téléphone du coffre-fort.
Dan a raccroché après avoir parlé à Olsson et a traité les policiers d'« idiots ». « Vous vous trompez de personne ! » a-t-il crié.
Jour 3
Le matin du 25 août, la police tenta une solution plus audacieuse. Un agent s'introduisit furtivement et ferma la porte du coffre, piégeant les otages à l'intérieur avec Olsson et Clark. La porte avait été laissée ouverte pour permettre à la police de leur fournir de la nourriture et de l'eau, et Olsson pouvait ainsi espérer s'échapper. Mais cet espoir s'était envolé.
Les autorités ont brouillé les signaux téléphoniques, empêchant les personnes à l'intérieur du coffre-fort d'appeler qui que ce soit, sauf la police, craignant que l'accès des médias au voleur ne le rende involontairement populaire auprès du public.
Nils Bejerot, un psychiatre consulté par la police, a estimé qu'une « amitié » avait pu se nouer entre les braqueurs et les otages. La police espérait que cela empêcherait Olsson de s'en prendre aux otages.
En fait, de tels liens s’étaient déjà formés et la police n’avait pas prévu leur force.

Des journalistes et des snipers de la police sont assis côte à côte sur le toit, en face de la Sveriges Kreditbank, au deuxième jour du braquage. Photo : AFP
L'après-midi, ignorant quand on lui donnerait à manger, Olsson sortit trois poires restantes du repas précédent, les coupa en deux et en distribua une portion à chacun. Tout le monde remarqua qu'Olsson prenait le plus petit morceau. « Quand il était bien traité, on le traitait comme un dieu », dit Safström.
Lorsqu'elle dort la nuit, Enmark entend les gens respirer et sait quand ils sont synchronisés. Elle essaie même de modifier sa propre respiration pour s'y adapter. « C'est notre monde », dit-elle. « Nous vivons dans le bunker, respirant et existant ensemble. Quiconque menace ce monde est notre ennemi. »
mercredi et jeudi
Le 26 août, le bruit du forage a semé le chaos dans le groupe.
La police a dit à Olsson qu'ils creusaient un trou assez grand pour qu'il puisse rendre son arme. Il a fallu des heures pour percer le plafond en acier et en béton. Les occupants du bunker avaient déjà compris la véritable raison de cette action : injecter des gaz lacrymogènes pour contraindre le braqueur à se rendre.
En réponse, Olsson a placé les otages sous le trou, des nœuds coulants autour du cou, les cordes nouées au-dessus d'une rangée de coffres-forts. Il a déclaré à la police que si un gaz rendait les otages inconscients, les nœuds coulants les tueraient.
« Je ne pensais pas qu'il allait nous pendre », a déclaré Enmark en 2016. Mais les otages s'inquiétaient des effets du gaz. Olsson leur a dit qu'après 15 minutes d'exposition au gaz lacrymogène, ils souffriraient tous de lésions cérébrales permanentes.
La police commença à percer d'autres trous au-dessus du coffre. Ils y envoyèrent un seau de pain, premier vrai repas des otages depuis des jours, leur offrant un bref répit. Alors qu'ils commençaient à fatiguer, Olsson fit tourner les nœuds coulants autour d'eux. Safström demanda au braqueur s'il pouvait en passer un à tous les otages.
« Safstrom est un homme, un vrai », a déclaré Olsson au New Yorker. « Il est prêt à servir d'otage à d'autres otages. »
Le dernier jour
Au sixième jour, l'équipe avait percé sept trous dans le plafond de la voûte, et dès que le dernier fut terminé, le gaz commença à affluer. Les otages tombèrent à genoux, toussant et suffoquant, avant qu'Olsson ne puisse leur ordonner de leur remettre les nœuds coulants autour du cou. Bientôt, la police entendit des cris : « Rendez-vous ! »
Après avoir ouvert la porte, la police ordonna aux otages de partir les premiers, mais ils refusèrent, craignant qu'Olsson et Clark ne soient tués par la police. Enmark et Oldgren embrassèrent Olsson, Safström lui serra la main et Lundblad demanda à Olsson de lui écrire une lettre. Le braqueur et son complice quittèrent alors le coffre de la banque et furent arrêtés par la police.
Olsson a été condamné à dix ans de prison et libéré au début des années 1980. Clark a été reconnu coupable par le tribunal de district, puis acquitté par la cour d'appel de Svea. Clark a soutenu avoir coopéré avec la police pour protéger les otages. Il a été renvoyé en prison pour purger le reste de sa peine et a été libéré en 2018.
À partir de cet événement, le Dr Bejerot a baptisé « syndrome de Normalmstorg » le phénomène par lequel les personnes enlevées développent des sentiments pour leurs ravisseurs. Ce terme a ensuite été rebaptisé « syndrome de Stockholm ».
Les associations professionnelles ne le reconnaissent pas comme une forme de diagnostic psychologique, bien qu'il ait été invoqué dans certains cas d'abus contre des prisonniers de guerre, notamment lors de l'enlèvement de Patty Hearst, un an après le braquage d'Olsson. Hearst, nièce d'un milliardaire américain, a développé de la sympathie pour ses ravisseurs et a rejoint le gang.
Certains experts se demandent s'il s'agit d'un trouble psychologique ou d'une simple stratégie de survie face à un danger extrême. Aux États-Unis, les experts en application de la loi affirment que le phénomène est rare et surmédiatisé. Pourtant, il apparaît fréquemment dans la culture populaire, notamment dans les livres, les films et la musique.
Enmark, qui a quitté la banque et est devenu psychothérapeute, a déclaré en 2016 que la relation des otages avec Olsson était plus une relation d'autoprotection qu'un syndrome.
« Je pense que les gens rejettent la faute sur la victime », a-t-elle dit. « Tout ce que j'ai fait, c'était par instinct de survie. Je voulais survivre. Je ne trouve pas ça si étrange. Que feriez-vous dans une telle situation ? »
Vu Hoang (selon le Washington Post )
Lien source


















































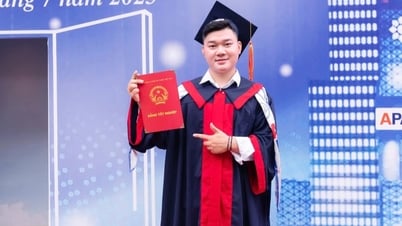
















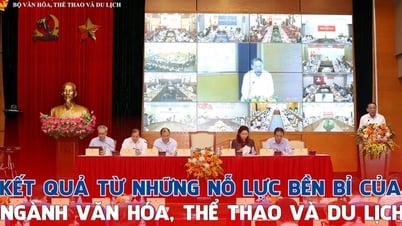


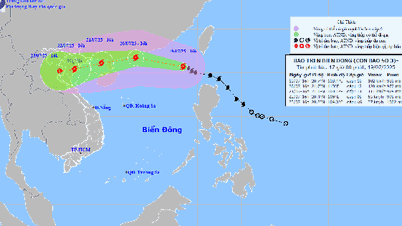




























Comment (0)